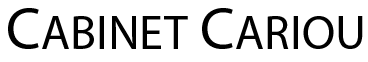Bail d’habitation
avril 2019 – avril 2020
par Nicolas Damas, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nancy,
Université de Lorraine, Institut François Gény (EA 7301)
PRÉAMBULE : LES BAUX D’HABITATION ET L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
I – EXÉCUTION DU BAIL
A – Obligations du locataire
1 – Obligations financières
2 – Sous-location
B – Obligations du bailleur
C – Vente du logement loué
II – FIN DU BAIL
A – Congés
1 – Congé par le locataire
2 – Congé par le bailleur
B – Transfert du contrat
C – Expulsion
III – ASPECTS PROCÉDURAUX
A – Action de groupe
B – Intérêt à agir
C – Lois de procédure
D – Juge des contentieux de la protection
Préambule : les baux d’habitation et l’état d’urgence sanitaire
Les questions soulevées par la situation sanitaire et le confinement sont nombreuses et affectent les rapports locatifs d’habitation, comme toutes les situations contractuelles. Il s’agit ici d’identifier certaines problématiques spécifiques rencontrées par les acteurs du logement locatif. Les textes de référence sont, outre la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 , principalement les ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-427 du 15 avril 2020 , portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Il faut également signaler l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 , uniquement consacrée à la prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 mai 2020 de la trêve hivernale tant en matière d’interruption de fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz pour cause d’impayé dans une résidence principale (CASF, art. L. 115-3, al. 3), qu’en matière d’expulsion (C. pr. exéc., art. L. 412-6). Cette date a été à nouveau reportée au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 .
L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 vise particulièrement le report de la date limite de délivrance d’un congé par le bailleur (V. N. Damas, Comment donner
congé en période d’urgence sanitaire ?, D. actu. 2 avr. 2020). Le texte dispose que : « Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1 er , de deux mois après la fin de cette période ».
La période définie au I de l’article 1 er renvoie à la période d’état d’urgence sanitaire (définie par la L. n° 2020-290 du 23 mars 2020) augmentée d’un mois. Le point de départ est selon cette loi, le 12 mars 2020, et le point d’arrivée est le 23 mai 2020 à minuit, soit, après augmentation d’un mois, le 23 juin 2020 à minuit (si l’on part du principe que la loi du 23 mars 2020 est bien entrée en vigueur à titre dérogatoire dès sa publication, et non le lendemain, comme le confirme le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 et la circulaire du 17 avril 2020 de présentation de cette ordonnance). Il faut toutefois garder à l’esprit que ce point d’arrivée est susceptible d’être modifié (avancé ou retardé) en fonction de l’évolution de la situation.
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 reporte la fin de l’état d’urgence au 10 juillet 2020 mais il est probable que les dispositions relatives aux délais soient à l’avenir décorrelées de
cette date.
Si la date limite pour délivrer congé intervient dans la période définie par l’article 1 er de l’ordonnance, l’article 5 précise que « cette période ou ce délai sont prolongés (…) de deux mois après la fin de cette période », soit, à l’heure actuelle, jusqu’au 23 août 2020 à minuit. La prolongation est automatiquement de deux mois. La question s’est posée de savoir quel délai de préavis devait alors respecter le bailleur. La difficulté vient de ce que le congé doit être délivré par le bailleur au moins six mois avant l’échéance du bail. Comme le texte de l’article 5 ne mentionne que le report de la période au cours de la date à laquelle le congé peut être délivré, sans expliciter la date de prise d’effet de ce congé décalé, et sans évoquer le décalage de l’échéance du contrat, il aurait pu être envisagé de considérer que le bail prenait fin à l’échéance normale du bail. L’interprétation aurait été similaire à celle prescrite par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (acte « réputé avoir été fait à temps »). Mais l’inconvénient pratique aurait été important, puisque le délai de préavis effectif aurait alors été raccourci, voire dans certains cas inexistant (pour des ex., V. N. Damas, préc.). La Direction des affaires civiles et du sceau a publié une fiche aux termes de laquelle le délai de préavis de six mois (ou trois dans le cadre d’un logement meublé) doit être respecté, s’agissant d’une « période exceptionnelle de prorogation temporaire du contrat de bail ». Cette solution est la seule envisageable, même si son assise textuelle nous paraît insuffisante.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifié par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 , traite des clauses pénales (dont le champ d’application est quasiment réduit à néant en matière de baux d’habitation depuis la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR) et surtout des clauses résolutoires, qui
sont bien plus fréquentes et prévoient la résiliation de plein droit en cas de manquement à l’une des obligations listées à l’article 4, g) , de la loi du 6 juillet 1989.
Dans sa version initiale (Ord. du 25 mars 2020), le dispositif aboutissait à ce que, si le délai de deux mois faisant suite au commandement d’avoir à payer (ou d’un mois suivant le commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurances) expirait au cours de la période définie par ce texte, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, la clause voyait ses effets reportés à compter du 24 juillet 2020 (un mois après le 24 juin). Le report d’un mois après la fin de la période était uniforme (« forfaitaire », selon les termes de la circulaire de présentation du 17 avr.).
Les modifications de cet article 4 par l’ordonnance du 15 avril 2020 sont de deux ordres.
D’une part, une distinction est opérée entre les obligations financières et non financières, et elle est motivée par le fait que les difficultés matérielles rencontrées par les débiteurs sont incontestables dès lors qu’il s’agit de faire quelque chose, alors que le paiement d’une somme d’argent n’est guère entravé par le confinement (sachant que des dispositifs spécifiques, tels que des délais de grâce, existent en tout état de cause dans le droit commun). D’autre part, le report n’est plus uniforme, mais dépend de plusieurs variables.
Lorsque la clause résolutoire vise l’inexécution d’une obligation financière (soit le non-paiement du loyer, du dépôt de garantie et des charges), le texte nouveau dispose que le report de sa prise d’effet est calculé (à l’heure actuelle) à compter du 24 juin, et correspond à la durée « égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ».
Dans le cas d’une obligation non financière, le nouvel alinéa 3 de l’article 4 de l’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit que cette date d’effet « est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période ».
Il est à noter que les textes réservent l’hypothèse où l’obligation est née postérieurement au 12 mars. Il faut préciser le sens à donner à la naissance de l’obligation : les exemples donnés par la circulaire de présentation visent la conclusion d’un contrat au cours de la période de protection, et il est vrai que l’obligation naît du contrat. Ce ne serait donc pas l’exigibilité de la créance qui serait à prendre en compte. Dans cette acception, seule l’hypothèse d’un contrat de bail conclu à compter du 12 mars 2020 aboutirait à un traitement différent.
Les exemples seraient peu nombreux et il est sans doute plus pertinent de prendre comme point de référence la notification du commandement visant la clause résolutoire (V. sur ces aspects : N. Damas, État d’urgence sanitaire et baux d’habitation, AJDI 2020. 353).
I – Exécution du bail
A – Obligations du locataire
1 – Obligations financières
L’obligation de payer le loyer constitue l’obligation essentielle du locataire, traduisant le caractère nécessairement onéreux de la relation locative. La liberté contractuelle n’est pas de mise sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones tendues où un encadrement des loyers peut être instauré. Mis en place par la loi ALUR du 24 mars 2014, ce dispositif nécessitait des textes d’application. C’est ainsi qu’ont été publiés le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015, ainsi que les arrêtés préfectoraux à Paris des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 juin 2017 et un arrêté préfectoral à Lille du 16 décembre 2016.
Les tribunaux administratifs de Lille (TA Lille, 17 oct. 2017, n° 1610304, D. 2018. 1117, obs. N. Damas ; AJDA 2018. 351, et 2017. 1983 ; AJDI 2018. 167, étude R. Corcos et C. Biscay) et de Paris (TA Paris, 28 nov. 2017, n° 1511828, D. 2017. 2478, obs. G. Hamel, et 2018. 1117, obs. N. Damas ; AJDA 2017. 2333 ; AJDI 2018. 125, obs. F. de La Vaissière, et 167, étude R. Corcos et C. Biscay) ont annulé ces arrêtés et la cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette annulation (CAA Paris, 26 juin 2018, n° 17PA03805, D. 2018. 1384, obs. Y. Rouquet, et 1772, obs. N. Reboul-Maupin ; AJDA 2018. 1306 ; AJDI 2019. 214, obs. N. Damas). Les juges du fond ont estimé que ce dispositif d’encadrement des loyers ne pouvait être mis en oeuvre dans la seule commune de Paris ou de Lille, mais aurait dû l’être dans toutes les communes comprises dans la « zone d’urbanisation continue » de l’agglomération parisienne et lilloise, telle qu’elle est définie par le décret du
10 mai 2013 relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants auquel renvoie le décret du 10 juin 2015 relatif à la mise oeuvre de ce dispositif.
Le Conseil d’État ( CE 5 juin 2019, n° 423696 , AJDA 2019. 1197 ; AJDI 2020. 216, obs. N. Damas) n’a pas repris cette lecture, et a estimé que, dans le cas où les données nécessaires n’étaient disponibles que pour une partie seulement des secteurs géographiques inclus dans une zone, il était possible au préfet, sans que le principe d’égalité y fasse obstacle, de mettre en oeuvre le dispositif dans cette partie des secteurs géographiques, dès lors que l’application de la loi dans ces seuls secteurs n’était pas de nature à créer un risque sérieux de distorsion vis-à-vis du marché immobilier des secteurs limitrophes, susceptible de compromettre l’objectif poursuivi par le législateur. Et, en l’espèce, en se référant à la spécificité du marché locatif à Paris, le Conseil d’État a estimé que la fixation des loyers de références dans les quatorze secteurs définis au sein du territoire de Paris n’était pas de nature à créer un risque sérieux de distorsion vis-à-vis du marché immobilier des secteurs limitrophes. En conséquence, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est annulé, pour erreur de droit, et l’affaire est renvoyée à la même cour. La décision
de renvoi sera intéressante car la question qui se pose est de déterminer si les arrêtés pourraient dès lors être rétroactivement validés : les baux conclus ou renouvelés au cours de cette période devraient donc avoir respecté les limites fixées par ces différents textes.
Pour l’avenir, la situation a été réglée par le législateur et par le gouvernement : depuis le 1 er juillet 2019, un nouvel encadrement des loyers est entré en vigueur, à Paris, sur le fondement
de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique, dite ELAN, du décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 et d’un arrêté préfectoral n° 2019-05-28-013 du 28 mai 2019 . Et par décret n° 2020-41 du 22 janvier 2020 (et suite à la publication d’un Arr. préfectoral le 30 janv. 2020), l’encadrement a
été rétabli à Lille, à compter du 1 er mars 2020.
Le conventionnement d’un logement se traduit par la conclusion d’une convention entre le bailleur et l’État, qui ouvre notamment au locataire le droit à l’aide personnalisée au logement (sous condition de ressources) et un loyer maximum applicable. Un tel conventionnement peut concerner des logements du secteur privé (CCH, art. L. 353-2 s.) ou du secteur social, habitation à loyers modérés (HLM) principalement (CCH, art. L. 353-14 s.). Les modalités d’entrée en vigueur et d’opposabilité de cette convention au locataire déjà en place sont différentes selon le secteur concerné. Dans le secteur privé, l’accord du locataire est requis en application de l’article L. 353-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et, en cas de refus du projet de bail que doit lui proposer le bailleur, le preneur n’aura évidemment pas droit à l’aide personnalisée au logement (APL). Dans le secteur social, la convention prend effet dès sa signature (CCH, art. L. 353-17) et l’article L. 353-16 précise qu’à « compter de la date d’entrée en vigueur de la convention ou de la date d’achèvement des travaux d’amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours » (sur la jurisprudence, relative notamment au supplément de loyer de solidarité, et les modifications législatives issues de la loi ELAN, V. A. Danon, Supplément de loyer de solidarité : deux poids et deux mesures imposés aux bailleurs sociaux, AJDI 2019. 577 et B. Wertenschlag, Mesures d’application de la loi ELAN du 23 novembre 2018 en matière de logement social, AJDI 2019. 587, spéc. 593). Ce sont les modalités de l’application immédiate de la convention qui sont précisées dans une décision de la Cour de cassation ( Civ. 3 e , 20 juin 2019, n° 18-17.028 , D. 2019. 1336 ; AJDI 2020. 132, obs. B. Wertenschlag). En l’espèce, une locataire a pris à bail un logement situé dans un immeuble appartenant à une société d’habitations à loyer modéré qui a par la suite signé une convention avec l’État en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. La locataire ayant refusé de justifier de ses ressources, la bailleresse lui a réclamé un supplément de loyer de solidarité liquidé au taux le plus élevé, puis l’a assignée en paiement et en résiliation du bail. La cour d’appel a rejeté cette demande au motif que la bailleresse n’a pas démontré avoir mis à disposition de la locataire une copie de la convention (alors que l’art. L. 353-16 CCH dispose qu’une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires), ce dont elle déduit que cette convention n’a pas
commencé à recevoir application.
La Cour de cassation casse cette décision et énonce que l’obligation de tenir à la disposition des locataires une copie de la convention n’est pas une condition préalable à son exécution.
En d’autres termes, l’entrée en vigueur de la convention n’est nullement conditionnée par cette formalité de la mise à disposition.
Seule la date de la signature de la convention importe. Si elle n’est pas tenue à la disposition du locataire, celui-ci pourra le reprocher au bailleur (par ex., en exigeant sous astreinte le
respect de cette obligation), mais il ne pourra pas s’en prévaloir pour échapper aux effets que cette convention produit.
2 – Sous-location
Dans une décision de principe (publiée au Rapport), la Cour de cassation a sanctionné de manière particulièrement vive le comportement du locataire qui avait sous-loué le logement
sans l’accord du bailleur ( Civ. 3 e , 12 sept. 2019, n° 18-20.727 , D. 2019. 2025, note J.-D. Pellier, 2199, chron. L. Jariel, et 2020. 353, obs. M. Mekki ; AJDI 2020. 205, obs. N. Damas,
et 2019. 796, obs. D. Houtcieff ; Dalloz IP/IT 2020. 122, obs. M. Serror Fienberg, B. Gagnaire et J.-M. Briquet ; RTD civ. 2019. 865, obs. H. Barbier, et 888, obs. P.-Y. Gautier). Le contexte était celui d’une sous-location touristique, favorisée par la modernité des moyens de communication (plateformes de services numériques telles qu’Airbnb), mais à laquelle le propriétaire va opposer avec succès les textes d’origine du code civil relatifs aux biens. En l’espèce, un litige entre le propriétaire d’un logement parisien et son locataire, à l’origine relatif à un congé pour reprise, s’est orienté vers une problématique strictement financière : ayant établi que son locataire avait sous-loué sans son autorisation son logement à des touristes pendant plusieurs années, le propriétaire lui a tout simplement réclamé le versement des sous-loyers correspondants.
La question posée à la Cour de cassation est sur ce point inédite. En effet, s’il est incontestable qu’une sous-location non autorisée constitue un manquement du locataire à ses obligations
(art. 8 de la L. du 6 juill. 1989), susceptible d’entraîner la résiliation judiciaire du bail ou un congé pour motif légitime et sérieux, la possibilité d’une indemnisation du propriétaire n’est tranchée ni par le droit commun du bail, ni par le droit spécial des baux d’habitation. Le premier réflexe serait alors de se référer au droit des contrats, et, plus particulièrement, à la responsabilité contractuelle. Mais une indemnisation du propriétaire suppose la démonstration d’un préjudice, ce qui peut être délicat lorsque le propriétaire a perçu le loyer principal.
De manière particulièrement audacieuse, le propriétaire a revendiqué les sous-loyers sur le fondement du droit des biens, et de la règle de l’accession. En application de l’article 546 du code civil, « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s’appelle droit d’accession ». L’article 547 précise que les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d’accession, et, en application de l’article 584 du code civil, « les fruits civils sont les loyers des maisons ». Même si les sous-loyers ne sont pas mentionnés expressément dans cette catégorie, la Cour de cassation applique de manière implacable la logique du droit des biens et ne laisse guère de porte de sortie pour le locataire (V. toutefois les positions nuancées et opposées de W. Dross, RTD civ. 2018. 936, et de D. Houtcieff, AJDI 2019. 796). L’argument selon lequel
une telle accession procurerait un enrichissement injustifié (C. civ., art. 1303) ne saurait prospérer, car précisément c’est le droit d’accession, corollaire du droit de propriété, qui justifie cette solution (l’argument a ainsi été rejeté dans le présent litige par la cour d’appel de Paris : Paris, 5 juin 2018, n° 16/10684, D. 2018. 1313 ; AJDI 2018. 864, obs. F. de La Vaissière ; Dalloz IP/IT 2018. 560, obs. Y. Rouquet ; JT 2018, n° 210, p. 10, obs. X. Delpech), et parce que l’article 1303-2 exclut l’indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel, ce qui est incontestablement le cas en matière de sous-location. De même, est rejeté l’argument formulé par le pourvoi, selon lequel les sous-loyers perçus par un locataire au titre d’une sous-location ne constitueraient pas des fruits civils appartenant au bailleur par accession mais l’équivalent économique du droit de jouissance conféré au preneur, lequel serait en droit de les percevoir et de les conserver, sauf à engager sa responsabilité envers le bailleur en cas de préjudice subi par celui-ci du fait de la méconnaissance d’une interdiction contractuelle de sous-location. La dimension contractuelle du rapport entre le locataire et son bailleur cède sous le poids du droit de propriété dont est titulaire le bailleur. Et c’est également pour cette raison que la relation sous locative, entre le preneur principal et le sous-locataire, certes inopposable au propriétaire, n’empêche pas ce dernier de réclamer les sous-loyers : il ne s’agit pas d’une entorse à l’effet relatif des contrats, car le bailleur n’est pas présenté comme le créancier du sous-locataire, mais comme un propriétaire pouvant revendiquer la propriété de ces sous-loyers en tant que fruits civils.
Il est important de noter que la portée de l’arrêt est, par ailleurs, générale en ce que la Cour de cassation vise la souslocation, sans distinguer selon la destination d’habitation, commerciale, professionnelle ou rurale de cette sous-location, ni de la location principale. Il restera encore à en préciser les règles de prescription : comme la solution ne repose que sur l’application du droit des biens, les prescriptions spécifiques (trois ans en matière de bail d’habitation, deux ans en matière de bail commercial) du droit des baux ne devraient pas pouvoir être opposées au bailleur. Le délai devrait dès lors être de cinq ans (C. civ., art. 2219).
B – Obligations du bailleur
L’obligation principale pesant sur le bailleur consiste à délivrer un logement décent (C. civ., art. 1719, et L. 6 juill. 1989, art. 6), mais ces textes lui imposent également de garantir une jouissance paisible au locataire.
Les conséquences à cet égard d’un arrêté de péril sont redoutables ( Civ. 3 e , 11 avr. 2019, n° 18-14.331 , AJDI 2020. 117, obs. N. Damas) : en application de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, « pour les locaux visés (…) par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée ». Une obligation de relogement est également mise à la charge du bailleur si, selon l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, « l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ».
En l’espèce, un bailleur assigne ses locataires en validation d’un congé pour reprise et en expulsion, ainsi qu’en paiement de loyers impayés, et les défendeurs s’opposent à cette demande et forment une demande reconventionnelle en remboursement d’un mois de loyer payé après la prise d’un arrêté de péril, et en indemnisation de leurs préjudices. La cour d’appel a, tout d’abord, refusé de tirer les conséquences de l’arrêté de péril sur l’obligation de paiement des loyers, au motif que cet arrêté ne visait que la solidité et la stabilité des dépendances, et non la maison d’habitation objet du bail. La décision est cassée au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, puisque l’arrêté de péril mentionnait notamment que « l’état de cet immeuble constitue un péril pour la sécurité des occupants » et que « le propriétaire devait effectuer des travaux de réfection de l’ensemble de la charpente-couverture ». De toute évidence, l’arrêté de péril ne se cantonnait pas aux seules dépendances.
La cour d’appel a, ensuite, refusé d’octroyer aux locataires une indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, au motif que ce préjudice ne serait nullement établi. La décision est, là encore, logiquement cassée au visa des articles 1147 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) et 1719 du code civil, puisque les juges du fond auraient dû rechercher, comme il le leur était demandé, si les désordres visés par l’arrêté de péril n’avaient pas troublé la jouissance par les locataires des locaux donnés à bail et ne leur avaient pas causé un préjudice moral.
C – Vente du logement loué
L’article 1743 du code civil prévoit que « si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le (…) locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ». La jurisprudence a toutefois assoupli cette règle en décidant qu’il suffit que l’acquéreur ait eu connaissance de l’existence du bail (ou de la présence du locataire) pour que la relation locative lui soit opposable (Civ. 3 e , 23 janv. 2007, n° 06-14.433). Le contentieux apparaît surtout en matière de ventes sur adjudication. En cette matière, existent des textes spécifiques, qui visent à protéger l’acquéreur. Ainsi, l’article 684 de l’ancien code de procédure civile prévoyait la nullité des baux sans date certaine, en particulier s’ils ont été conclus après le commandement. En droit positif, l’article L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que « les baux consentis par le débiteur après l’acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur ». La Cour de cassation avait également tempéré cette rigueur de la protection accordée à l’acquéreur, en estimant que le critère de la connaissance de la relation locative par celui-ci devait permettre au locataire d’éviter la sanction prévue par le texte (Civ. 3 e , 23 mars 2011, n° 10-10.804, D. 2011. 1073, obs. Y. Rouquet, 1596, note C. Juillet ; AJDI 2011. 785, obs. N. Damas – application de l’anc. art. 684 C. pr. civ.). Elle vient d’adopter la même lecture généreuse sous l’empire de l’article L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution ( Civ. 2 e , 27 févr. 2020, n° 18-19.174 , D. 2020. 494 ; Rev. prat. rec. 2020. 9, obs. U. Schreiber). En l’espèce, un commandement valant saisie immobilière a été délivré au propriétaire d’un logement en 2013. Le procès-verbal de description mentionne l’existence d’un bail (conclu en 2008). Le logement a été adjugé au créancier poursuivant en 2014, qui a entamé une procédure d’expulsion des occupants, lesquels se sont prévalus de leur bail et de sa tacite reconduction en 2014. La Cour de cassation fait droit aux demandes des locataires en relevant que « la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu, et que le bail, même conclu après la publication d’un tel commandement est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication ». Cette solution s’écarte incontestablement de la lettre du texte, et paraît justifiée par la volonté de la Cour de cassation d’appliquer à l’adjudicataire un principe de cohérence : s’il acquiert un logement en sachant qu’il fait l’objet d’un bail, il ne pourra pas prétendre à son inopposabilité.
II – Fin du bail
A – Congés
1 – Congé par le locataire
La Cour de cassation adopte une lecture littérale de l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, en ce qu’elle a durci les modalités de justification par le locataire du cas de préavis réduit dont il se prévaut ( Civ. 3 e , 11 avr. 2019, n° 18-14.256 , D. 2019. 819 ; AJDI 2020. 116, obs. N. Damas ; Rev. prat. rec. 2020. 45,
chron. D. Gantschnig). Il est acquis que le locataire a la possibilité de délivrer congé à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Toutefois, dans certaines situations
énumérées par l’article 15, I, et étendues par la loi ALUR, le préavis est réduit à un mois. Le texte nouveau précise : « Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ». C’est alors le moment et le mode de justification du motif de préavis réduit qui deviennent déterminants.
Avant la loi ALUR, la jurisprudence autorisait le locataire à ne pas invoquer un cas de préavis réduit dès le congé, et en admettait une justification tardive, même en cours de procédure
judiciaire (y compris à hauteur d’appel), ce qui faisait subir au bailleur le risque de cette procédure (par ex. Civ. 3 e , 7 juill. 2004, n° 03-14.439, AJDI 2004. 889, obs. Y. Rouquet ; 13 déc.
2005, n° 04-19.585, AJDI 2006. 568, obs. F. de La Vaissière ; 30 juin 2010, n° 09-16.244, D. 2010. 1788, obs. Y. Rouquet, et 2011. 1181, obs. N. Damas ; AJDI 2011. 287 et 294, obs. N. Damas).
Dorénavant, la démarche du locataire doit impérativement s’articuler ainsi : le motif de congé doit figurer dans le congé et le locataire doit joindre un justificatif (tel qu’un document attestant de la perte d’emploi – lettre de licenciement, par ex.). Aucune possibilité de compléter l’envoi du congé ne sera offerte par la suite : la sanction est, en effet, automatique, et consiste en l’application d’un délai de préavis de trois mois. Les situations comprises seraient, schématiquement, les suivantes : si le congé n’évoque même pas le bénéfice d’un préavis réduit ; si le congé invoque un cas de préavis réduit, mais ne comprend aucun justificatif ; si le congé invoque un cas de préavis réduit, mais comprend un justificatif qui n’est pas pertinent.
Quelques questions restent en suspens toutefois : d’une part, il est curieux que le texte n’ait pas prévu que la mention du cas de préavis réduit doive figurer dans le congé même, ni que le justificatif doive y être annexé. Au contraire, le texte ne se réfère qu’au moment de l’envoi de la lettre de congé, ce qui pourrait permettre un envoi séparé (concomitant toutefois), ce qui devrait cependant être rarissime. D’autre part, la justification du motif géographique (le fait que le logement se situe dans une zone tendue définie à l’article 17 de la L. du 6 juill. 1989) résulte de l’adresse même du local loué, et ne devrait pas nécessiter le moindre justificatif par le locataire (qui devra toutefois invoquer ce motif géographique dans le congé), malgré la lettre du texte. Enfin, il reste à déterminer si un locataire pourrait invoquer un oubli, voire une erreur, afin de bénéficier tout de même d’un préavis réduit. S’il n’est pas possible de rétracter un congé une fois qu’il a été notifié (N. Damas, H. Des Lyons, G. Marot et Y. Rouquet, Droit et pratique des baux d’habitation, Dalloz Référence, 2017, n° 531.12), il a été proposé d’appliquer au congé, acte unilatéral, la théorie des vices du consentement, et en particulier l’erreur de droit qui aurait été commise par le locataire négligent (V. en ce sens V. Zalewski Sicard, Rev. loyers 2019. 997). Cette voie nous paraît difficile à admettre, dans la mesure où le preneur ne pouvait ignorer que la loi du 6 juillet 1989 était applicable : la théorie de l’erreur ne peut servir à justifier le non-respect des modalités de délivrance du congé.
2 – Congé par le bailleur
Le contentieux relatif à l’application dans le temps de la loi ALUR se tarit peu à peu, mais les arrêts rendus sont riches d’enseignement car leurs solutions seront certainement transposables aux réformes qui ne manqueront pas d’intervenir en cette matière dans les années à venir. Au terme d’une jurisprudence audacieuse, car s’affranchissant de la lettre du texte, la Cour de cassation a décidé que la loi ALUR devait régir les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées (Cass., avis, 16 févr. 2015, n° 14-70.011, D. 2015. 489, et 1178, obs. N. Damas ; AJDI 2015. 608, obs. N. Damas ; RTD civ. 2015. 569, obs. P. Deumier). C’est ainsi que, à propos des congés délivrés par le bailleur, elle a appliqué les dispositions issues de la loi ALUR à un congé délivré après son entrée en vigueur, et ce même si le bail avait été conclu antérieurement à cette entrée en vigueur (Civ. 3 e , 23 nov. 2017, n° 16-20.475, D. 2017. 2426, et 2018. 1117, obs. N. Damas ; AJDI 2018. 281, obs. N. Damas). La situation est, en revanche, différente lorsque le congé a été délivré avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR ( Civ. 3 e , 19 déc. 2019, n° 18-20.854 , D. 2020. 11 ; RTD civ. 2020. 91, obs. H. Barbier).
En l’espèce, un congé à fin de reprise pour habiter a été délivré le 19 décembre 2013 à effet au 24 juin 2014. Le locataire en a contesté la validité, sur le fondement des dispositions issues de la loi ALUR qui ont notamment renforcé le pouvoir du juge en lui permettant de « déclarer non valide le congé si la nonreconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes » (V. N. Damas, La loi ALUR et les baux d’habitation, AJDI 2014. 334, spéc. 346).
La cour d’appel a exclu l’application de la loi ALUR, mais au motif, curieux, que, selon l’article 82, II, de la loi du 6 août 2015 (dite Macron), les dispositions nouvelles ne s’appliquent qu’aux seuls contrats en cours au 7 août 2015. C’est en réalité au regard des seules dispositions transitoires mises en place par la loi ALUR elle-même que le litige devait être ici réglé. C’est pourquoi la Cour de cassation a approuvé le rejet de l’application de la loi ALUR, mais par substitution de motifs : après avoir rappelé que la loi n’a pas d’effet rétroactif, elle précise que l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, n’est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur.
Cette solution n’est pas nouvelle dans la mesure où la Cour de cassation avait déjà eu à statuer sur cette question (Civ. 3 e , 1 er déc. 2016, n° 15-19.915, AJDI 2017. 119 ; 29 nov. 2018, n° 17-28.001, AJDI 2019. 62). La persistance de pourvois sur cette question a sans doute conduit la Cour à exprimer clairement le critère mis en oeuvre : c’est la date de délivrance du congé qui importe, et non pas la date d’échéance du bail (et donc de prise d’effet du congé).
Ainsi, la loi nouvelle qui entre en vigueur avant l’échéance du bail, mais après la délivrance du congé, n’a pas vocation à s’appliquer à ce congé. Il est heureux que ce rappel soit nettement énoncé, car il est vrai qu’on ne saurait accepter que la validité d’un acte soit appréciée selon des critères qui ont été édictés postérieurement.
Lorsque le bail est soumis à la loi du 1 er septembre 1948, le régime des congés présente de nombreuses spécificités : c’est ainsi qu’en application des articles 19, alinéa 1 er , et 20 bis , les modalités de congé pour reprise diffèrent de celles prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, sans qu’il n’y ait d’atteinte au principe d’égalité ( Civ. 3 e , 24 oct. 2019, n° 19-15.766 , D. 2019. 2135 ; RTD civ. 2020. 134, obs. P.-Y. Gautier). En l’espèce, le bailleur, une société civile immobilière (SCI), a délivré congé au profit de l’un de ses associés. Si cette possibilité est ouverte par la loi du 6 juillet 1989 dès lors que la SCI est familiale, c’est-à-dire constituée uniquement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus (art. 13 L. 6 juill. 1989), elle ne l’est pas par la loi du 1 er septembre 1948, sauf si la société est une société d’attribution en jouissance, ce qui est une forme sans doute relativement rare de structure bailleresse.
En conséquence, le congé a été annulé et, dans le cadre de son pourvoi, la société bailleresse a présenté à la Cour de cassation, par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité, en invoquant une atteinte disproportionnée au droit de propriété et une violation du principe d’égalité.
La réponse de la Cour de cassation est sans surprise : la question posée ne présente pas un caractère sérieux, et ce sur les deux points invoqués (V. déjà, à propos de certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989 eu égard au principe d’égalité et à la protection du droit de propriété : Civ. 3 e , 16 avr. 2015, n° 14-25.381, AJDA 2015. 1621 ; Civ. 2 e , 19 janv. 2017, n° 16-40.244, AJDI 2017. 217 ; Cons. const., 6 avr. 2018, n° 2018-697 QPC, D. 2018. 721, et 2019. 1129, obs. N. Damas ; AJDA 2018. 772 ; Constitutions 2018. 193 ; Civ. 2 e , 19 sept. 2019, n° 19-40.023).
D’une part, le bailleur personne physique ou membre d’une société immobilière titulaire d’un droit personnel de jouissance sur le bien loué n’est pas dans une situation identique à celle du bailleur constitué en société civile dont les parts ou actions ne confèrent pas le même droit aux associés, de sorte qu’en n’accordant pas le droit de reprise aux sociétés civiles immobilières familiales, le législateur a fondé cette différence de traitement sur une différence de situation objective en rapport direct avec l’objet de la loi visant à assurer la stabilité du droit au logement du locataire. Il s’agit, en effet, de concilier le droit au logement avec le droit de propriété, et il peut paraître légitime de n’accorder le droit de reprise pour habiter qu’aux bailleurs pouvant effectivement habiter (c’est-à-dire les personnes physiques), et seulement à titre exceptionnel à certaines personnes morales afin de permettre à leurs associés d’habiter dans les lieux repris. La loi du 1 er septembre 1948 a opté pour les seules personnes morales attribuant aux associés un droit personnel de jouissance. Il n’est pas contraire au principe d’égalité de ne pas ouvrir cette possibilité aux autres personnes morales (même les SCI familiales), car l’attribution d’un droit personnel de jouissance est un critère permettant de distinguer objectivement entre ces différentes sociétés.
D’autre part, l’objectif d’intérêt général de la loi, à savoir favoriser le droit au logement du locataire, peut tout à fait justifier cette conception restreinte de la qualité de bailleur personne morale pouvant délivrer un congé pour reprise.
B – Transfert du contrat
En matière de handicap, la Cour de cassation ne s’arrête pas à une lecture littérale des textes. Tel est l’enseignement d’une décision qui statue sur le sort d’un bail portant sur un logement
HLM, à la suite du décès du locataire ( Civ. 3 e , 12 déc. 2019, n° 18-13.476 , D. 2019. 2409).
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dresse une liste de bénéficiaires auxquels le contrat de location est transféré, mais ce texte doit être lu au regard de l’article 40, I, de la même loi, qui prévoit des conditions supplémentaires lorsque le bailleur est un organisme HLM : le bénéficiaire doit remplir les conditions d’attribution d’un tel logement et le logement doit être adapté à la taille du ménage. Toutefois, le texte précise que « les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans » (sur les modifications apportées à cet alinéa par la loi ELAN du 23 nov. 2018, non applicable en l’espèce, V. N. Damas, La loi ELAN et les baux d’habitation, AJDI 2019. 26, spéc. 31).
Dans le présent litige, le bailleur social a assigné le fils du locataire décédé, en expulsion comme occupant sans droit ni titre. Il apparaît, en effet, que ce descendant ne remplissait pas
la condition liée à l’adaptation du logement à la taille de son ménage. Le défendeur a, quant à lui, fait valoir son statut de travailleur handicapé afin de bénéficier de l’exemption énoncée
à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, et visant la personne présentant un handicap.
La cour d’appel a refusé d’assimiler la notion de travailleur handicapé à celle de personne présentant un handicap, en se fondant sur la différence de texte applicable à chaque hypothèse.
Le travailleur handicapé est, selon l’article L. 5213-1 du code du travail, « toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit, quant à lui, le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les deux textes imposent donc de constater une altération des fonctions notamment physiques, mentales ou psychiques, mais le code de l’action sociale et des familles semble exiger un degré plus élevé car il mentionne le caractère substantiel, durable ou définitif de l’altération subie, quand le code du travail ne qualifie pas cette altération.
La Cour de cassation refuse toutefois d’entrer dans cette distinction, en énonçant de manière lapidaire que « le travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail bénéficie de l’exception prévue à l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en faveur des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale
et des familles ».
C – Expulsion
La jurisprudence de la Cour de cassation est nette et tranchée :
lorsqu’un conflit de normes apparaît, mettant aux prises le droit de propriété avec d’autres droits fondamentaux, en l’occurrence le droit au respect du domicile et de la vie privée et
familiale, et le droit de disposer d’un logement décent, la victoire revient en principe au droit de propriété ( Civ. 3 e , 4 juill. 2019, n° 18-17.119 , D. 2019. 2163, note R. Boffa, et 2199,
chron. A.-L. Collomp ; AJDI 2020. 139, obs. N. Le Rudulier).
En l’espèce, plusieurs personnes occupent avec leurs caravanes une parcelle et se voient assigner par le propriétaire en expulsion devant le juge des référés. C’est notamment l’appréciation des pouvoirs du juge des référés qui est au coeur du litige. La cour d’appel va prononcer leur expulsion en estimant que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, ce qui justifie le recours à cette procédure rapide. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme l’appréciation des juges du fond. Elle s’inscrit en cela dans la lignée de décisions antérieures (V. par ex. Civ. 3 e , 21 déc. 2017, n° 16-25.406, D. 2018. 7, 1328, chron. A.-L. Méano, et 1772, obs. N. Reboul-Maupin ; AJDI 2018. 375, obs. F. Cohet, et 582, étude H. Leyrat ; RDI 2018. 215, obs. E. Gavin-Millan-Oosterlynck ; 17 mai 2018, n° 16-15.792, D. 2018. 1071, et 1772, obs. N. Reboul-Maupin ; AJDI 2019. 73, obs. F. Cohet ; RDI 2018. 446, obs. J.-L. Bergel ; RTD civ. 2018. 708, obs. W. Dross ; 20 déc. 2018, n° 16-24.821) :
l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Il en résulte que la Cour de cassation ne rejette pas le contrôle de proportionnalité qui est la règle en cette matière sous l’influence de la jurisprudence européenne. Mais elle n’opère qu’un contrôle formel, en ce que le vainqueur est désigné par avance : les termes « ne saurait être disproportionnée » édictent une « forme de présomption irréfragable de proportionnalité de la sanction » (R. Boffa, La propriété et le contrôle de proportionnalité, D. 2019. 2163). Il importe finalement peu que les occupants soient domiciliés dans les caravanes installées sur les parcelles d’autrui : leur expulsion est une issue nécessairement légitime pour le propriétaire.
Une autre décision s’est inscrite dans la même ligne ( Civ. 3 e , 28 nov. 2019, n° 17-22.810 , D. 2019. 2350 ; Légipresse 2020. 64, étude G. Loiseau ; RTD civ. 2020. 156, obs. W. Dross). En l’espèce, une commune, propriétaire de parcelles en bordure d’autoroute sur lesquelles est installé un campement de gens du voyage, a assigné en référé les occupants pour obtenir leur expulsion. La cour d’appel a refusé cette demande en estimant que, si les personnes dont l’expulsion est demandée occupent sans droit ni titre ces parcelles et que le trouble manifestement illicite est avéré du fait d’une occupation irrégulière des lieux, il ressort cependant des pièces versées aux débats que l’expulsion est de nature à compromettre l’accès aux droits, notamment, en matière de prise en charge scolaire, d’emploi et d’insertion sociale, de familles ayant établi sur les terrains litigieux leur domicile, même précaire, en l’absence de toute proposition de mesures alternatives d’hébergement de la part des pouvoirs publics, de sorte que la mesure sollicitée apparaît disproportionnée au regard des droits au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, à la protection de leur domicile et à la préservation de l’intérêt de leurs enfants.
Au visa des articles 544 et 545 du code civil, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1 er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention, la Cour de cassation casse cette décision en énonçant que « l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ».
À nouveau, la Cour de cassation n’opère qu’un contrôle formel de proportionnalité.
Il a été, par ailleurs, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition de la loi ELAN du 23 novembre 2018, qui a durci les modalités d’expulsion des occupants sans droit ni titre lorsqu’ils sont entrés dans les lieux par voie de fait : en effet, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit dorénavant que le délai de deux mois suivant le commandement ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Auparavant, la réduction ou la suppression de ce délai n’était qu’une faculté pour le juge (de même, le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’art. L. 412-6 du même code est dorénavant automatiquement refusé lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait : V. N. Damas, La loi ELAN et les baux d’habitation, AJDI 2019. 26, spéc. 34). Le tribunal d’instance qui a saisi de cette question la Cour de cassation l’a interrogée sur la possible contrariété de cette disposition nouvelle avec le principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation, le droit de mener une vie familiale normale et l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement. La Cour de cassation a sans ambiguïté refusé le renvoi au Conseil constitutionnel, estimant que la question, qui n’était pas nouvelle, n’était pas non plus sérieuse, dans la mesure où la disposition nouvelle permet la conciliation entre le droit de propriété et la possibilité pour toute personne, découlant des exigences constitutionnelles de dignité humaine et de droit à une vie familiale normale, de disposer d’un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle, qu’il appartient au législateur de mettre en oeuvre ( Civ. 3 e , 20 juin 2019, n° 19-40.010 , D. 2019. 1801, obs. Y. Strickler ; AJDI 2020. 134, obs. F. Cohet). Il ne s’agit donc pas de considérer isolément la mesure litigieuse, mais de l’envisager plus largement au sein de l’édifice législatif encadrant l’expulsion d’un lieu habité. Les garanties accordées par ailleurs aux personnes dont l’expulsion est demandée (not. la possibilité de demander un délai en application de l’art. L. 412-3 C. pr. exéc.) sont ainsi estimées suffisantes.
En outre, la Cour de cassation a été saisie des conséquences de l’annulation d’une mesure d’expulsion, et plus particulièrement de la possibilité pour l’occupant expulsé d’être réintégré dans
le logement ( Civ. 3 e , 12 déc. 2019, n° 18-22.410 , D. 2020. 11). Cette réintégration, si elle est ordonnée par le tribunal, constitue une obligation de faire à la charge du propriétaire.
L’exécution forcée en nature d’une telle obligation est susceptible de fournir au créancier la meilleure satisfaction possible. Si l’ancien article 1142 du code civil ne lui laissait qu’un rôle
résiduel (même si la Cour de cassation avait adopté une lecture plus favorable au créancier), le nouvel article 1221 est bien plus volontariste : « le créancier d’une obligation peut, après
mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son
intérêt pour le créancier ». En l’espèce, un bailleur social a fait constater la résiliation du bail conclu avec un locataire qui a dès lors été expulsé. Ce locataire a toutefois contesté son
expulsion et a obtenu, par un arrêt définitif rendu en 2014, d’une part, la nullité de la procédure d’expulsion et, d’autre part, et en conséquence, sa réintégration (ce qui est de droit
même si la personne expulsée n’avait plus aucun droit d’occupation : Civ. 2 e , 16 mai 2019, n° 18-16.934 , D. 2019. 1112).
Le bailleur n’obtempère pas et loue en 2017 le logement à un tiers. L’occupant initial agit alors en expulsion de ce nouveau locataire et en réintégration forcée.
La cour d’appel statuant en référé condamne le bailleur social à faire libérer le logement nouvellement occupé en vue de permettre la réintégration dans les lieux de l’occupant initial, au
motif que le trouble illicite est manifestement caractérisé par la relocation en 2017 par le bailleur du logement litigieux. Les juges du fond indiquent également que le bailleur n’allègue
pas l’existence d’une cause étrangère revêtant le caractère de la force majeure qui s’opposerait à la réintégration du demandeur, la société d’HLM étant tenue d’exécuter l’arrêt de 2014
et ayant eu tout loisir de ne pas relouer l’appartement litigieux.
La décision est cassée et la Cour de cassation énonce que le fait que le logement était loué à un tiers aurait dû conduire la cour d’appel à en déduire l’impossibilité de procéder à la réintégration
de l’occupant initial.
La décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure, rendue à propos de l’obligation de délivrance s’imposant au bailleur (Civ. 1 re , 27 nov. 2008, n° 07-11.282, AJDI 2009. 218, obs. F. de La Vaissière) ou à propos d’une réintégration (Civ. 3 e , 26 mars 2013, n° 12-14.731). Il est certain que le bailleur ne pouvait probablement pas arguer efficacement d’un cas de force majeure, dans la mesure où il est à l’origine de cette impossibilité, ayant, postérieurement à sa condamnation, reloué le bien (V. déjà Civ. 3 e , 28 sept. 2005, n° 04-13.720, D. 2005. 2480, et 2006. 958, obs. N. Damas ; AJDI 2005. 901, obs. Y. Rouquet, selon lequel « l’occupation illicite du bien loué par un tiers qui en empêche sa délivrance au preneur ne constitue une cause étrangère qui ne peut être imputée au bailleur que si elle revêt les caractères de la force majeure »). Mais la démonstration d’un cas de force majeure n’est pas ici nécessaire, car la notion d’impossibilité (matérielle ou juridique) est suffisante, ce qui est explicitement exprimé au nouvel article 1221 du code civil.
Enfin, il faut signaler le décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 qui a modifié les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, pris en application de l’article
L. 433-2 de ce code (lui-même modifié par la L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 pour la justice du XXI e siècle), et relatifs à la mise en vente aux enchères publiques des biens laissés par l’occupant
dans le logement. Il est notamment détaillé le sort de ces biens selon qu’ils ont ou non une valeur marchande. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2020.
III – Aspects procéduraux
A – Action de groupe
L’action de groupe a été introduite dans le droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite Hamon, relative à la consommation, et permet à des consommateurs, victimes d’un même préjudice de la part d’un professionnel, de se regrouper et d’agir en justice. Plus précisément, une association de défense des consommateurs agréée peut poursuivre en justice la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs « à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ». Les premières saisines d’un tribunal sur ce fondement nouveau (C. consom., art. L. 423-1, devenu L. 623-1) ont précisément concerné un litige locatif, notamment un problème de charges récupérables (litige Paris Habitat) ou de facturation d’un avis d’échéance (litige Foncia), sans toutefois que la question de l’applicabilité du texte consumériste à la location immobilière ne soit véritablement tranchée (A. Danon, D. actu. 5 juill. 2019 ; V. toutefois TGI Nanterre, 8 e ch., 14 mai 2018, n° 14/11846, D. 2019. 607, obs. E. Poillot ; JA 2018, n° 582,
p. 12, obs. X. Delpech).
C’est tout l’intérêt d’un arrêt de la Cour de cassation, qui oppose l’association Confédération nationale du logement à un bailleur social à propos d’une clause insérée dans les contrats de location imposant une pénalité en cas de retard de paiement du loyer ( Civ. 1 re , 19 juin 2019, n° 18-10.424 , D. 2019. 1332, et 2020. 624, obs. E. Poillot ; JA 2019, n° 603, p. 10, obs. X. Delpech, et 2020, n° 612, p. 32, étude S. Damarey ; AJDI 2020. 217, obs. N. Damas ; Rev. prat. rec. 2020. 23, chron. R. Bouniol ; RTD civ. 2019. 605, obs. P.-Y. Gautier). La possible méconnaissance par le bailleur de l’article 4, i) , de la loi du 6 juillet 1989 est rapidement apparue secondaire, et c’est sur le terrain procédural que la discussion s’est développée : afin que l’association de consommateurs puisse faire valoir en justice le préjudice subi par les locataires, encore faut-il que le contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 entre dans le champ d’application de l’article L. 623-1 du code de la consommation.
Depuis un arrêt de principe du 26 janvier 2017 (Civ. 3 e , 26 janv. 2017, n° 15-27.580, D. 2017. 388, note V. Pezzella, 1149, obs. N. Damas, et 2018. 583, obs. E. Poillot ; AJDI 2017. 443, obs.
N. Damas, et 498, étude M. Moreau et J. Adda ; RTD civ. 2017. 372, obs. H. Barbier), la Cour de cassation a énoncé que le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation. Il faut néanmoins nuancer cette affirmation catégorique car elle ne paraît s’appliquer que lorsqu’il y a conflit entre des dispositions contradictoires issues de ces deux branches du droit (V. ainsi Civ. 3 e , 12 janv. 2017, n° 16-10.324, D. 2017. 430, note S. Tisseyre, et 1149, obs. N. Damas ; AJDI 2017. 358,
obs. Y. Rouquet, et 498, étude M. Moreau et J. Adda ; AJ fam. 2017. 199, obs. J. Casey ; RTD civ. 2017. 129, obs. H. Barbier, et 418, obs. P.-Y. Gautier, qui vérifie la qualification de clause
abusive à propos d’une stipulation d’un bail). Il reste dès lors toujours possible d’appliquer une disposition issue du droit de la consommation lorsqu’elle n’a pas d’équivalent dans la loi
du 6 juillet 1989 (selon C. Aubert de Vincelles, la distinction s’impose selon la nature, nationale ou supranationale, de la disposition consumériste : Éclairage européen sur la banalisation
de la notion de « service » en droit de la consommation, D. 2019. 548). C’est précisément le cas de la disposition, purement procédurale, relative à l’action de groupe.
Il faut encore vérifier que les conditions posées par l’article L. 623-1 du code de la consommation soient remplies. Tel est le cas pour ce qui est des paramètres liés à la qualification
de consommateur du locataire (pour qui la conclusion du bail est sans rapport direct avec son activité professionnelle) et de professionnel du bailleur social. Reste la nature du contrat
conclu, et c’est sur ce point que le bailleur va obtenir gain de cause. En effet, l’article L. 623-1 ne visait que la vente de biens ou la fourniture de services. Le bail, n’opérant pas transfert de
la propriété, ne saurait être qualifié de contrat de vente. Il ne devrait pas non plus être qualifié de contrat de prestation de services, car il n’impose pas au bailleur, à titre principal, l’exécution
d’une prestation (V. P.-Y. Gautier, RTD civ. 2019. 605 ; contra , C. Aubert de Vincelles, préc., au regard de la qualification en droit de l’Union européenne, du contrat de services).
Le bail étant qualifié par la Cour de cassation de contrat de fourniture de chose, il ne peut être soumis à la loi Hamon sur l’action de groupe, et l’action en justice de l’association est déclarée irrecevable.
La portée de cette décision est toutefois à relativiser car la loi ELAN du 23 novembre 2018 a modifié la rédaction de l’article L. 623-1 du code de la consommation, en prévoyant dorénavant son application « dans le cadre de la location d’un bien immobilier », ce qui dépasse d’ailleurs le simple cadre de la location d’habitation.
B – Intérêt à agir
Lorsqu’un bailleur a délivré congé et que son locataire n’entend pas quitter les lieux, le bailleur doit prendre l’initiative d’engager une action judiciaire en validation du congé et en expulsion. La Cour de cassation a rendu une décision très intéressante sur les modalités d’appréciation de l’intérêt à agir ( Civ. 3 e , 11 juill. 2019, n° 18-18.184 , D. 2019. 1494 ; AJDI 2020. 218, obs. N. Damas).
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Et l’article 122 du même code qualifie de fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour, notamment, défaut d’intérêt à agir. Ce sont ces règles procédurales qu’un locataire a tenté d’opposer à son bailleur qui avait commis une erreur de détermination de l’échéance du bail en cours.
En l’espèce, le bailleur a délivré à son locataire un congé pour reprise, avec effet au 30 septembre 2015, alors qu’en réalité (les débats devant le premier juge le révéleront) ce congé ne pouvait prendre effet avant le 23 juin 2016 (en application de l’art. 51 de la L. du 23 déc. 1986, fixant au 24 juin 1983 le point de départ des périodes triennales pour les baux à durée indéterminée conclus avant cette date). Entre-temps, toutefois, le bailleur a assigné dès janvier 2016 en validation du congé.
Le locataire a alors soulevé une fin de non-recevoir, en rappelant la règle selon laquelle n’a pas un intérêt né et actuel à agir le bailleur qui assigne en validation d’un congé avant la date d’effet de celui-ci (Civ. 3 e , 31 oct. 2006, n° 05-11.929, AJDI 2007. 310, à propos d’un congé pour reprise ; V. aussi Civ. 3 e , 29 sept. 2004, n° 00-16.524, RTD civ. 2004. 774, obs. R. Perrot, à propos de l’action en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire). La prétention est rejetée tant par la cour d’appel que par la Cour de cassation, qui énonce que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. S’il est certain que le congé ainsi délivré ne pourra pas produire ses effets à la date qu’il mentionne (le congé prématuré n’est pas nul mais ses effets sont reportés à la date à laquelle il aurait dû être notifié : Civ. 3 e , 13 juin 2006, n° 05-13.252, AJDI 2006. 743), il n’en demeure pas moins que ce constat ne peut être que l’aboutissement de la procédure que le bailleur aura initiée : c’est donc à la date d’engagement de cette procédure qu’il faut se placer pour apprécier son intérêt à agir, sans préjuger de la décision à intervenir (Civ. 2 e , 13 févr. 2003, n° 01-03.272, D. 2003. 805 : l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice). Or l’assignation a bien été délivrée postérieurement à la prise d’effet supposée du congé, ce qui est la seule condition requise afin que le bailleur présente un intérêt à agir.
C – Lois de procédure
La lutte contre les locations touristiques illégales est à l’origine d’un nombre important de contentieux, souvent à l’initiative de la ville de Paris. Dans une décision ( Civ. 3 e , 16 mai 2019, n° 17-24.474 , D. 2019. 1104 ; AJDI 2020. 204, obs. N. Damas), la Cour de cassation réaffirme l’application immédiate d’une loi de procédure. En l’espèce, un bailleur a été assigné en référé par le procureur de la République sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, et a été condamné à une amende civile de 2 500 €. Le procureur de la République a interjeté appel. La cour d’appel, devant laquelle la ville de Paris est intervenue volontairement à l’instance, a porté l’amende à 15 000 €. Le bailleur s’est pourvu en cassation en invoquant deux arguments procéduraux, relatifs à l’intervention volontaire de la ville de Paris, et ce alors que l’appel du parquet était visiblement tardif.
En premier lieu, il a été soulevé l’irrecevabilité de l’intervention de la ville de Paris, en ce que cette possibilité d’initier les poursuites n’a été reconnue que par l’article 59 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle. Ce texte a modifié l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation en augmentant le montant maximum de l’amende à 50 000 €, et en précisant que la requête est formulée par le maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé (la L. n° 2018-1021 du 23 nov. 2018, dite ELAN, a ensuite supprimé la référence au maire). Or, en l’espèce, la procédure a été engagée en juillet 2015 et l’appel par le parquet a été interjeté en novembre 2015, soit bien avant l’entrée en vigueur du texte nouveau. Mais l’argument n’a pas prospéré devant la Cour de cassation, car il est établi que les lois de procédure sont d’application immédiate aux instances en cours (V. déjà Cass., avis, 22 mars 1999, n° 99-00.001, Bull. civ., n° 2 : qui vise les principes généraux du droit transitoire, selon lesquels, en l’absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécution sont d’application immédiate ). La ville de Paris était dès lors fondée à intervenir, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, et ce même à hauteur de cour.
En second lieu, le bailleur a prétendu que l’intervention volontaire de la ville de Paris ne constituait que l’accessoire de l’appel du procureur de la République, et il en déduisait que celui-ci étant tardif, l’intervention aurait dû être automatiquement jugée irrecevable. L’argument est, là encore, rejeté au motif que l’intervenant volontaire se prévaut ici d’un droit propre, et la Cour de cassation en déduit que le sort de son intervention n’est pas lié à celui de l’action principale (V. déjà Civ. 2 e , 13 juill. 2006, n° 05-16.579, D. 2006. 2211, et 2007. 1380, obs. P. Julien ; Procédures 2006, n° 204, obs. R. Perrot). Ce sont les articles 328 à 330 du code de procédure civile qui fondent cette distinction (V. A. Bolze, note ss l’arrêt commenté, D. actu. 18 juin 2019).
D – Juge des contentieux de la protection
De nombreux décrets d’application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, pour une justice du XXI e siècle, ont été publiés au cours de la période de référence afin de permettre l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles au 1 er janvier 2020. Ainsi, l’article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 modifie l’article 761 du code de procédure civile et énonce que « les parties sont dispensées de constituer avocat (…) dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ».
De même, l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a créé un article 750-1 du code de procédure civile, prévoyant qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ».
En outre, l’article 17 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 a créé, d’une part, un article R. 213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, selon lequel le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3 (qui lui-même dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre »), et, d’autre part, un article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, selonlequel le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 €, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées notamment à l’article L. 213-4-4 (qui dispose que le « juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 »).