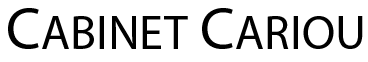État d’urgence sanitaire et baux d’habitation
par Nicolas Damas
Maître de conférences, université de Lorraine (Nancy – IFG EA 7301)
Les questions soulevées par la situation sanitaire et le confinement sont nombreuses et affectent les rapports locatifs d’habitation, comme toutes les situations contractuelles. Il s’agit ici d’identifier certaines problématiques spécifiques rencontrées par les acteurs du logement locatif, qui risquent de s’accentuer avec la durée de la crise.
■■Les textes
Il sera fait référence à plusieurs reprises aux textes issus principalement de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020. L’ordonnance no 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, a également apporté certaines modifications importantes. Afin de faciliter le propos, les deux textes pertinents
sont ici reproduits :
■■Art. 2 de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
« Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »
« Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. »
(Source AJDI Mai 2020)
Ce dernier alinéa a été ajouté par l’article 2 de l’ordonnance no 2020-427 du 15 avr. 2020, lequel précise, in fine, que « cette modification de l’article 2 a un caractère interprétatif ».
■■Art. 4 de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 : « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de
sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
« Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. »
Cet article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 a été modifié par l’article 4 de l’ordonnance no 2020-427 du 15 avril 2020 qui a remplacé l’alinéa 2 (en italique ci-dessus) par les deux alinéas suivants :
« Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
« La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un
délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. »
La période définie par l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 faisait référence aux dispositions de l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19, selon lequel le point de départ de l’état d’urgence était le 12 mars 2020 et le point d’arrivée deux mois après son entrée en vigueur (soit le 23 mai 2020 dans l’hypothèse où, comme l’affirme le rapport au président de la République sur l’ordonnance no 2020-427 du 15 avril 2020, la loi est exceptionnellement entrée en vigueur au jour de la publication au journal officiel, et non le lendemain). L’article 1er de l’ordonnance y ajoutait un mois afin de constituer la période juridiquement protégée (PJP) auxquels les articles suivants se réfèrent. Cette période commence donc
le 12 mars 2020 et se termine le 23 juin 2020 à minuit. La référence à la période d’état d’urgence sanitaire a toutefois posé des difficultés car celle-ci est évolutive, donc instable, risquant
de décaler d’autant la PJP. C’est pourquoi l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 a, en modifiant l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, clairement acté que
la PJP s’étendait du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, et supprimé toute référence, devenue inutile, à la période d’état d’urgence sanitaire.
La sécurité et la prévisibilité des dispositions en sortent renforcées.
■■La formation du bail
La conclusion d’un contrat n’est nullement empêchée, du strict point de vue juridique, par la situation sanitaire. Il est tout à fait possible pour l’une des parties de signer le contrat de bail en deux
exemplaires puis de les envoyer à l’autre partie par voie postale, qui régularisera et retournera à l’expéditeur son exemplaire. Il est même envisageable de considérer qu’un échange
de courriers (postaux ou électroniques) peut valoir échange de consentements marquant la conclusion du bail, dès lors que le logement loué est bien identifié, les conditions financières déterminées, et la date de prise d’effet et la durée du bail mentionnées.
Certes, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose la rédaction d’un écrit, mais cette exigence n’est pas sanctionnée à peine de nullité (elle ouvre la possibilité pour l’une des parties, en l’occurrence
le locataire, d’exiger la régularisation par écrit de la relation locative).
C’est en revanche sur des aspects purement matériels que la conclusion du bail va être rendue difficile.
D’une part, en amont, la visite des lieux sera bien sûr rendue, sinon impossible, du moins très hasardeuse en période de confinement. D’autre part, l’établissement de l’état des lieux va être délicat, puisqu’il est en principe signé contradictoirement par les parties.
Le recours à un mandataire pourrait être la solution (à coût partagé selon les modalités prévues par l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989). En outre, la réalisation des diagnostics techniques pourra aussi poser des difficultés, même si les délais de validité de ceux-ci peuvent permettre au bailleur de réutiliser des diagnostics relativement anciens.
Enfin, quand bien même tous ces éléments ont pu être récoltés, et le bail signé, il reste la difficulté de l’ouverture des compteurs (électricité, eau, gaz…) et du déménagement (le gouvernement a indiqué sur le site www.gouvernement.fr/info-coronavirus que seuls les déménagements qui ne peuvent pas être reportés sont autorisés)…
Si un bail a été par exemple signé le 5 mars 2020 pour une prise d’effet au 1er avril 2020, plusieurs difficultés peuvent se présenter.
■■L’état des lieux n’a pu être réalisé, et les clés n’ont pas été remises au locataire. Celui-ci ne peut donc se voir réclamer de payer le loyer, faute de délivrance par le bailleur. Et le bailleur ne devrait pas se voir reprocher cette absence de délivrance en raison de la force majeure (du fait du prince : interdiction des déplacements non essentiels) prévue par l’article 1218
du code civil. Le contrat est donc suspendu (art. 1218, al. 2).
■■L’état des lieux a été réalisé, et les clés remises au locataire. Celui-ci ne peut toutefois pas déménager. Peut-il invoquer la force majeure pour se dispenser de payer le loyer ? La situation n’est certes pas deson fait, semble bien imprévisible lors de la conclusion du bail et inévitable (s’il ne parvient pas à faire appel à un professionnel du déménagement). Mais la Cour de cassation a déjà décidé que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 sept. 2014,
n° 13-20.306, D. 2014. 2217, note J. François ; Rev. sociétés 2015. 23, note C. Juillet ; RTD civ. 2014. 890, obs. H. Barbier). Le locataire devrait dès lors régler les loyers.
Il faut rappeler que la caractérisation de la force majeure nécessite la démonstration d’une imprévisibilité.
Par conséquent, si les difficultés ci-dessus relatées apparaissent à l’occasion d’un bail signé après la mise en oeuvre du confinement, les parties ne peuvent prétendre avoir été surprises par la situation et invoquer un cas de force majeure.
Le refus de conclure un bail au profit d’un professionnel de santé pourrait-il constituer une discrimination ?
Une autre difficulté peut se présenter en matière de colocation.
En application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité du colocataire ayant donné congé cesse à la date d’effet du congé si un nouveau colocataire figure au bail. Les circonstances actuelles pouvant retarder la conclusion du bail avec le colocataire remplaçant, le colocataire ayant donné congé risque de voir la durée de sa solidarité avec le colocataire restant s’allonger, jusqu’à six mois après la date d’effet de son congé… En revanche, si le bail a été conclu avec le nouveau colocataire, il importera peu que celui-ci ne puisse matériellement emménager : le colocataire
sortant (qui aura lui quitté les lieux) verra sa solidarité cesser dès la date d’effet de son congé.
■■Discrimination
Même si les excès rapportés semblent heureusement rares, il a été fait état par les médias de voisins, voire de propriétaires, enjoignant au locataire exerçant une profession l’exposant à un contact
prolongé avec des malades du covid-19, ou hébergeant une telle personne, de « déménager ». On peut imaginer aussi que certains bailleurs seraient hélas tentés de refuser de conclure un bail avec ces professionnels. Ces comportements sont sanctionnés par le droit positif.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’un locataire ne peut se voir interdire l’exercice d’une pratique professionnelle par son bailleur, dès lors que cette pratique
n’est pas exercée au sein du logement (ce qui contreviendrait à l’usage de ce logement ; V. art. L. 631-7-3 CCH). De même, un locataire peut héberger toute personne de son choix, ce qu’aucune clause ne peut limiter (art. 4 n de la loi du 6 juillet 1989).
Ensuite, la question se pose de savoir si le refus de conclure un bail au profit d’un professionnel de santé, par exemple, pourrait constituer une discrimination. L’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 renvoie sur ce point à l’article 225-1 du code pénal qui liste de manière limitative les paramètres illicites sur le fondement desquels une différence de traitement serait qualifiée de « discriminatoire ». Or, la situation professionnelle n’y figure pas. C’est pourquoi, d’ailleurs, un bailleur peut préférer un salarié en CDI plutôt qu’en CDD, un cadre plutôt qu’un employé,
un fonctionnaire plutôt qu’un salarié du secteur privé. Toutefois, le caractère discriminatoire est avéré lorsque la sélection s’effectue sur l’état de santé, et c’est bien ce qui motiverait en réalité
ici le bailleur : le professionnel n’est pas rejeté tant pour sa profession que pour les risques que celle-ci induit pour sa santé et celle des tiers (en tant que vecteur potentiel du virus). Le bailleur s’exposerait dès lors à des poursuites correctionnelles pour discrimination (et à l’indemnisation du préjudice subi par le candidat évincé).
■■L’exécution du bail
Les obligations respectives du bailleur et du locataire et les éventuels manquements doivent être appréciés à l’aune des critères de la force majeure édictés à l’article 1218
du code civil (applicable aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er octobre 2016), ou de l’ancien article 1148 du code civil (pour les contrats antérieurs).
Les obligations financières du locataire n’ont pas fait l’objet d’une intervention spécifique de la part du législateur (si l’on excepte, très indirectement, le report de la mise en oeuvre de la contemporéanisation des aides personnalisées au logement, V. D. actu. 20 mars 2020, Y. Rouquet et B. Wertenschlag, AJDI 2020. xxx).
En particulier, il n’est pas prévu une quelconque « suspension » de l’obligation de payer les loyers (comme c’est le cas, sous certaines conditions, en matière de bail commercial en application de l’ordonnance no 2020-316 du 25 mars 2020 et des décrets no 2020-371 du 30 mars 2020, no 2020-378 du 31 mars 2020 et no 2020-394 du 2 avril 2020). Le locataire pourrait être tenté de recourir au droit commun des contrats et de faire valoir, par exemple, sa privation soudaine de ressources financières afin de ne pas payer le loyer ou les charges. Mais là encore, la force majeure ne devrait pas pouvoir être invoquée, car elle ne s’applique pas à une obligation de payer une somme d’argent (Com. 16 sept. 2014, n° 13-20.306, préc.). Un locataire qui cesserait de payer son loyer pourrait être ainsi assigné en paiement forcé (voire, si le bail est authentique, faire l’objet d’une voie d’exécution).
Les obligations non financières pourraient en revanche susciter l’application de la force majeure, si les conditions sont remplies.
Ainsi pourrait-elle être invoquée par le débiteur d’une obligation de réparation (on imagine que ce serait plutôt le bailleur qui en pratique pourrait s’en prévaloir, pour tenter de s’exonérer d’une
obligation lui incombant – l’obligation d’entretien et de réparations locatives pesant sur le locataire, moins étendue, n’étant en général pas réclamée en cours de bail par le propriétaire), si les critères de la force majeure sont remplis. Mais si une atteinte est ainsi portée à l’obligation de délivrance, le locataire pourrait en retour suspendre le paiement du loyer. L’inexécution par le bailleur de son obligation ne sera sans doute pas aisée à justifier sur le fondement de la force majeure, car l’activité de dépannage est relativement assurée (sauf défaut de pièces de rechange) et le caractère insurmontable ferait sans doute ainsi défaut. Il est à anticiper une certaine bienveillance des juges envers des retards dans l’exécution de ces différentes obligations.
La clause résolutoire, figurant très souvent au bail et prévoyant la résiliation de plein droit en cas de manquement à l’une des obligations listées à l’article 4 g, tombe quant à elle sous le coup de
l’article 4 de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020, puisqu’elle y est mentionnée expressément. Mais le régime édicté par cet article 4 a été modifié par l’ordonnance no 2020-427 du 15 avril 2020.
Dans sa version initiale, le dispositif aboutissait à ce que, si le délai de deux mois faisant suite au commandement d’avoir à payer (ou d’un mois suivant le commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurances) expirait au cours de la période définie par ce texte, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, la clause aurait dû produire ses effets à compter du 24 juillet 2020 (un mois après le 23 juin). Le report d’un mois après la fin de la période était uniforme (« forfaitaire », selon les termes de la circulaire de présentation du 17 avril).
Les modifications de cet article 4 par l’ordonnance du 15 avril 2020 sont de deux ordres. D’une part, une distinction est opérée entre les obligations financières et non financières, et elle est motivée par le fait que les difficultés matérielles rencontrées par les débiteurs sont incontestables dès lors qu’il s’agit de faire quelque chose, alors que le paiement d’une somme d’argent n’est guère entravé par le confinement (sachant que des dispositifs spécifiques, tels que des délais de grâce, existent en tout état de cause dans le droit commun). D’autre part, le report n’est plus uniforme, mais Il n’est pas prévu une quelconque « suspension » de l’obligation de payer les loyers dépend de plusieurs variables. Il restera par ailleurs à déterminer si la computation des délais prorogés (qui peuvent impliquer un calcul en jours) répond elle-même aux règles de procédure civile, en particulier la prorogation lorsque le dernier jour tombe un samedi
dimanche ou jour férié. Les exemples donnés ci-après en font toutefois abstraction.
■■Lorsque la clause résolutoire vise l’inexécution d’une obligation financière (soit le non-paiement du loyer, du dépôt de garantie et des charges), le texte nouveau dispose que le report de sa prise d’effet est calculé à compter du 24 juin, et correspond à la durée « égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ».
■■Lorsque la clause vise l’inexécution d’une obligation non financière (telle que la non-souscription d’une assurance), il faut alors distinguer selon que la date de prise d’effet de la clause résolutoire se produit au cours de la période définie par l’ordonnance (soit jusqu’au 23 juin inclus), ou postérieurement.
Dans le premier cas, le régime est similaire à celui exposé à propos de l’inexécution d’une obligation financière.
Dans le second cas, le nouvel alinéa 3 de l’article 4 de l’ordonnance du 15 avril 2020 prévoit que cette date d’effet « est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période ». Les exemples ne peuvent se concevoir sans tenter d’identifier au préalable ce qu’il faut entendre par la naissance de l’obligation.
■■La naissance de l’obligation. Les textes, relatifs aux obligations tant financières que non financières, réservent en effet l’hypothèse où l’obligation est née postérieurement au 12 mars. Il faut donc préciser le sens à donner à la naissance de l’obligation. Et selon nous, deux interprétations peuvent être défendues.
Première interprétation : Les exemples figurant dans la circulaire de présentation visent la conclusion d’un contrat au cours de la période de protection, et il vrai que l’obligation naît du contrat. Il y aurait donc cette date unique à prendre en compte, quelle que soit l’exigibilité de la créance de loyers. Il a pu toutefois être suggéré qu’en matière locative, la naissance de l’obligation de payer les loyers naîtrait au fur et à mesure de l’exécution du bail (M. Mekki, Calcul des délais : l’ordonnance « rectificative » du 15 avril 2020, JCP N 2020. 1084). Pourtant, comme l’avait souligné un auteur, la distinction doit être faite entre la naissance et l’échéance de la créance : « La créance de loyers ayant son origine dans un contrat de bail unique peut apparaître, non pas véritablement
comme une créance à “naissance successive”, mais plutôt comme une créance à « exécution successive » » (E. Putman, note sous Com. 24 oct. 1995, JCP 1996. II. 22578). La date à prendre en compte serait dès lors bien la conclusion du bail. Ce rejet de toute référence à l’exigibilité de la créance se comprendrait également en raison des nombreuses difficultés pratiques qu’il y aurait à distinguer au sein d’un même commandement de payer selon que les créances de loyer recensées seraient exigibles avant ou après le 12 mars 2020… Dans cette acception, seule l’hypothèse d’un contrat de bail conclu à compter du 12 mars 2020 et faisant ensuite l’objet d’un manquement susceptible d’être sanctionné par la mise en oeuvre de la clause résolutoire serait visée (soit quantitativement sans doute assez peu de situations).
Seconde interprétation : Une autre interprétation pourrait alors être envisagée, qui consisterait à se référer à la date de signification du commandement (de payer ou de justifier de l’assurance) pour caractériser la naissance de l’obligation entendue alors comme l’obligation devant être exécutée dans un délai déterminé, selon les termes de l’article 4, à peine d’être sanctionnée après ce délai par le jeu de la clause résolutoire. Dans cette perspective, on pourrait considérer que le commandement de payer faisant naître le délai de deux mois ferait également « naître » l’obligation,
non pas initiale de payer les loyers (qui remonte à la conclusion du bail), mais celle, postérieure, de s’acquitter des termes du commandement, et dont le défaut d’exécution dans le délai déterminé rend applicable la clause résolutoire. Cette solution qui relie « l’obligation » à la sanction par la clause résolutoire aurait en outre le mérite de conférer une plus grande ampleur à la disposition, puisque tout commandement de payer signifié à compter du 12 mars y serait soumis. Elle serait enfin en cohérence avec la position de la jurisprudence rendue en des circonstances similaires (Civ. 3e, 22 mai 1970, n° 69-12.393, Bull. civ. III, n° 352, cité par C. Grimaldi, F.-L. Simon, J.-Ch. Simon, in Le sort des clauses sanctionnant un retard dans l’exécution d’un contrat et Covid-19 : L’apport de la jurisprudence rendue en application de la loi du 31 juillet 1968 relative aux forclusions encourues du fait des événements de mai et juin 1968, LDR, 27 avr. 2020).
Cette interprétation a notre faveur (V. également B. Vial-Pedroletti, Épidémie de Covid-19 et bail d’habitation : les questions que pose le confinement, Loyers et copr. mai 2020), et ce même si l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée ne se réfère pas à la mise en demeure. Nous présentons toutefois les effets des deux interprétations dans les exemples suivants :
Exemple 1
Un commandement de payer visant la clause résolutoire est délivré le 20 janvier 2020, ouvrant un délai de deux mois expirant le 20 mars 2020. La clause résolutoire ne sera dès lors acquise qu’après un délai calculé à compter du 24 juin et correspondant au temps écoulé entre le 12 mars et le 20 mars (soit neuf jours), soit à compter du 2 juillet. Un règlement de sa dette par le locataire le 30 juin empêcherait la clause résolutoire de produire ses effets.
Exemple 2
Un commandement de payer visant la clause résolutoire est délivré le 20 mai 2020, ouvrant un délai de deux mois expirant le 20 juillet 2020.
Cette date étant postérieure à la période définie par l’ordonnance, aucune prorogation n’est accordée, et la clause résolutoire produira ses effets à l’expiration de ce délai initial.
Exemple 3
Un commandement visant la clause résolutoire relative au défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs est délivré le 20 février 2020, ouvrant un délai d’un mois expirant le 20 mars 2020. La clause résolutoire ne sera dès lors acquise qu’après un délai calculé à compter du 24 juin et correspondant au temps écoulé entre le 12 mars et le 20 mars (soit neuf jours), soit à compter du 2 juillet.
Les délais de grâce qui auraient pu être accordés par le juge, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, seront-ils eux-mêmes suspendus au titre de l’article 2 de l’ordonnance du
25 mars 2020 ? Que décider si un plan d’apurement a été homologué ou décidé par le juge, accordant par exemple, à compter du 1er janvier 2020, six mois
au locataire pour apurer sa dette, et si le locataire ne règle pas l’échéance d’avril 2020 ? La clause résolutoire reprend-t-elle son plein effet, ou le délai
est-il suspendu ? Le doute est permis sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance, car le paiement d’une dette n’est pas mentionné en son alinéa 1er, et l’alinéa 2 n’évoque que le « paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ». En l’occurrence, même s’il s’agit pour le locataire de conserver son droit au bail, le paiement n’est pas prescrit par un texte mais par la décision judiciaire… Toutefois, peut-être faudrait-il ici encore faire application de l’article 4 de l’ordonnance qui paralyse les effets de la clause
résolutoire (V. ci-dessus), ce qui, indirectement, pourrait paralyser l’application (et la sanction) du plan d’apurement judiciaire…
■■Fin du bail
Restitution du dépôt de garantie : le délai imparti au bailleur pour restituer le dépôt de garantie peut-il être décalé du fait de la situation sanitaire ? Comme il s’agit d’une obligation financière, il
ne pourrait se prévaloir d’un cas de force majeure. Mais il s’agit surtout de déterminer si l’article 2 ou l’article 4 de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 peut être appliqué au délai de restitution du dépôt de garantie.
Un bailleur pourrait faire valoir que le report est nécessaire car il n’a pas pu matériellement faire réaliser un devis ou les réparations.
Mais ce constat matériel ne saurait suffire car il faut que cette hypothèse entre dans les conditions posées par les textes.
Deux obstacles majeurs s’opposent à ce que l’article 2 de l’ordonnance puisse être invoqué : d’une part, le paiement n’est pas prévu par le texte (sauf selon l’alinéa 2 de l’article 2, mais uniquement afin de conserver ou d’acquérir un droit, ce qui n’est pas le cas ici) et, d’autre part, l’acte devait être réalisé à peine de sanction, nullité, etc. Or, le défaut de restitution est sanctionné par l’application d’une majoration (de 10 % du loyer mensuel par mois de retard), qui n’a pas, selon le Conseil constitutionnel, la nature d’une sanction ayant le caractère d’une punition (Cons. const., 22 févr. 2019, n° 2018-766 QPC, D. 2019. 429, et les obs. ; ibid. 1129, obs. N. Damas).
En revanche, l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 pourrait être invoqué par le bailleur, car il vise « les astreintes ». Or, la majoration légale pourrait être assimilée à une astreinte légale (elle n’est d’ailleurs pas cumulable avec les intérêts moratoires : Civ. 3e, 15 nov. 2018, n° 17-26.986, D. 2018. 2232 ; AJDI 2019. 536, obs. F. de La Vaissière ; Rev. prat. rec. 2020. 45, chron. D. Gantschnig 17-26.986).
Dans l’exemple 6 précité, il en résulterait un décalage de l’application de la majoration selon les nouvelles règles posées par l’article 4 de l’ordonnance du 15 avril 2020 (report, à compter du
24 juin, d’un délai correspondant à celui existant entre le 12 mars et le 1er avril, soit de vingt jours). Le décalage serait à nouveau à calculer pour chaque période mensuelle commencée en retard. Dans le même ordre d’idée, si la majoration avait déjà commencé à courir avant le 12 mars 2020, elle serait suspendue pendant la période allant jusqu’au 23 juin 2020 inclus.
Les congés. La délivrance d’un congé suscite de nombreuses questions qui sont traitées par ailleurs (V. N. Damas, dans ce dossier, Comment donner congé en période d’urgence sanitaire ?, p. XXX), notamment en ce qui concerne l’application de l’article 5 de l’ordonnance. Un aspect plus spécifique sera traité ici, relatif aux effets du congé.
■■D’une part, un congé pour vendre délivré par le bailleur présente la particularité d’ouvrir un droit de préemption au profit du locataire, car le congé vaut offre de vente. L’article 15-II de la loi du
6 juillet 1989 prévoit alors un enchaînement de délais puisque le locataire a deux mois pour se prononcer sur cette offre de vente, et s’il accepte, il disposera d’un délai de deux mois, éventuellement porté à quatre mois s’il entend recourir à un prêt, pour réaliser la vente (le raisonnement est identique pour ce qui est du droit de préemption subsidiaire, et pour le droit de préemption offert par les articles 10 et 10-1 de la loi du 31 décembre 1975).
Exemple 4 (obligation financière)
Un bail a été conclu en 2019. Un commandement de payer visant la clause résolutoire est délivré le 20 mars 2020, ouvrant un délai de deux mois expirant le
20 mai 2020.
Variante 1 : (la naissance de l’obligation est interprétée comme la date de conclusion du contrat) : la clause résolutoire ne sera dès lors acquise qu’après un délai calculé à compter du 24 juin et correspondant au temps écoulé entre le 12 mars et le 20 mai (soit 2 mois et 9 jours), soit à compter du 2 septembre.
Variante 2 : (la naissance de l’obligation est interprétée comme la date de signification du commandement visant la clause résolutoire) : la clause résolutoire
ne sera dès lors acquise qu’après un délai calculé à compter du 24 juin et correspondant au temps écoulé entre le 20 mars et le 20 mai (soit 2 mois), soit à compter du 24 août.
Exemple 5 (obligation non financière)
Un bail est conclu et a pris effet le 23 avril 2020. Un commandement visant la clause résolutoire relative au défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs est délivré le 20 juin 2020, ouvrant un délai d’un mois expirant le 20 juillet 2020.
Variante 1 : (la naissance de l’obligation est interprétée comme la date de conclusion du contrat) : La clause résolutoire ne sera dès lors acquise qu’après un délai calculé à compter du 21 juillet et correspondant au temps écoulé entre le 23 avril et le 23 juin (soit 2 mois), soit à compter du 21 septembre
Variante 2 : (la naissance de l’obligation est interprétée comme la date de signification du commandement visant la clause résolutoire) : La clause résolutoire ne sera dès lors acquise qu’après un délai calculé à compter du 21 juillet et correspondant au temps écoulé entre le 20 juin et le 23 juin (soit 4 jours),
soit à compter du 24 juillet…
Exemple 6
Soit une remise des clés le 1er février 2020, étant précisé que l’état des lieux révèle des dégradations. Le bailleur a deux mois pour restituer le solde du dépôt de garantie, soit jusqu’au 1er avril 2020, qui se situe en pleine période d’urgence sanitaire. Le défaut de restitution du solde du dépôt de garantie à cette date entraîne-t-il décompte de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ? Ou le point de départ de la pénalité de retard est-il reporté au 24 août 2020 ?
La question qui se pose est de savoir si l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 s’applique à ces deux hypothèses et il faut donc vérifier les critères posés par ce texte. Il s’agit tout d’abord bien
à chaque fois d’un acte (accepter, conclure la vente) qui est attendu avant l’expiration du délai. Chacun de ces délais est en outre prescrit par la loi, ce qui permet de remplir une autre des conditions posées par l’article 2 de l’ordonnance. Il faut toutefois qu’une dernière exigence soit vérifiée : la sanction de la passivité du sujet de droit. La situation est assez évidente pour ce qui est du délai de régularisation de la vente : si la vente n’est pas réalisée dans les deux ou quatre mois, l’acceptation est nulle de plein droit. La
nullité constitue bien une sanction qui plus est expressément visée par l’article 2. En revanche, la question se pose avec plus d’acuité en amont, à propos de l’absence de réaction du locataire à l’issue du délai de réflexion de deux mois (V. C. Gijsbers, Flash Cridon de Paris, 30 mars 2020 ; M. Mekki, L’ordonnance relative au report des délais échus : kit de premiers secours pour les rédacteurs contractuels, JCP N, 1er avril 2020 – la question se pose en des termes similaires à propos du délai SRU de rétractation). Il perd son droit d’acquérir, mais le doute est permis sur la réalité de cette « sanction », qui peut en réalité s’analyser comme le simple choix dont dispose le locataire (acheter ou ne pas acheter).
Il nous semble que l’on peut tout même rattacher cette hypothèse à une sanction au sens de l’article 2 de l’ordonnance et, par conséquent, faire entrer le délai de réflexion offert au locataire dans le champ de ce texte. En effet, l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 précise d’une part que « l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis » (elle est « caduque » dans le cadre du droit de préemption subsidiaire), et d’autre part qu’« à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ». Ainsi, en raison du contexte lié au congé, l’offre de vente faite au locataire ne peut être considérée comme un simple mécanisme d’option de contracter. L’arrivée du terme du délai de réflexion entraîne une double sanction : la perte de validité de l’offre (ou sa caducité pour le droit de préemption subsidiaire) et la déchéance de tout droit d’occupation au terme du préavis.
Le doute a pu être ravivé par l’article 2 de l’ordonnance no 2020-427 du 15 avril 2020 qui exclut l’application de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 aux délais de réflexion. À première lecture, l’on pourrait penser que le débat est tranché et que le délai de réflexion offert au locataire pour accepter l’offre de vente doit être exclu du processus de report des délais. Mais cette première lecture serait hâtive, car le rapport au président de la République, relatif à l’ordonnance du 15 avril 2020, rappelle que les délais de réflexion sont définis comme étant ceux « avant l’expiration desquels le destinataire d‘une offre contractuelle ne peut manifester son acceptation » (reprenant ainsi les termes de l’article 1122 du code civil). En d’autres termes, ce délai est restreint aux hypothèses dans lesquelles le destinataire d’une offre est obligé de surseoir à l’expression de son consentement (il en va ainsi par exemple du délai de réflexion préalable à l’acte de vente non précédé d’un avant-contrat, visé par l’article L. 271-1 du CCH). Or, ce n’est nullement l’objet du délai de réflexion offert au locataire, qui constitue
un délai d’efficacité et même de validité de l’offre : un délai minimal au cours duquel le destinataire peut à tout moment consentir à la vente. L’on remarquera en dernier lieu que ni la loi du 6 juillet 1989 ni celle du 31 décembre 1975 ne qualifient de « délai de réflexion » le délai légal accompagnant l’offre de vente (mais de délai au cours duquel l’offre est valable), et ce n’est souvent que par raccourci que la notion de « délai de réflexion » est parfois utilisée. Ces deux hypothèses (délai de deux mois pour accepter l’offre de vente ; délai de deux ou quatre mois pour régulariser la vente) nous paraissent dès lors, sous les réserves exprimées ci-dessus, entrer dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 même modifié par l’ordonnance du 15 avril 2020 (V. en ce sens D. actu. 16 avr. 2020, A. Gouezel), et par conséquent, les actes qui auraient dû être accomplis au cours de cette période seront réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période soit en l’état le 23 juin 2020, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Exemple 7
Soit un bail avec échéance au 30 septembre 2020. Un congé avec offre de vente a été délivré le 14 mars 2020, faisant naître un délai de réflexion expirant deux mois après le début théorique du préavis (31 mars), soit le 31 mai 2020. Le locataire pourra accepter jusqu’au 23 août 2020 (il profitera totalement du délai de deux mois offert à compter du 24 juin 2020, car ce délai de
deux mois correspond au délai légal de réflexion).
Exemple 8
Soit un bail qui a fait l’objet d’un congé pour vendre en 2019, et le locataire n’a pas accepté l’offre de vente.
Le processus de vente mené par le bailleur le conduit à devoir purger un droit de préemption subsidiaire (du fait de conditions plus favorables envisagées avec un
tiers acquéreur). L’offre de vente est ainsi notifiée au locataire le 5 mars 2020. Elle fait naître un délai de réflexion d’un mois (et non plus de deux mois comme
pour l’offre initiale), soit jusqu’au 5 avril 2020. Le locataire pourra dès lors accepter jusqu’au 23 juillet 2020, soit un mois après le 23 juin 2020 (il est en effet précisé
par l’article 2 que le délai supplémentaire « ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux
mois » ; or le délai légal est ici fixé à un mois).
Exemple 9
Soit un bail avec échéance au 31 août 2020. Un congé avec offre de vente a été délivré le 14 février 2020, faisant naître un délai de réflexion expirant deux mois
après le début théorique du préavis (29 février), soit le 30 avril 2020.
Modalités 1 : le locataire n’aura eu que douze jours « efficaces » de réflexion jusqu’au 12 mars 2020, début de la période de protection. Il pourra manifester sa volonté d’accepter après le 30 avril, et même après le 23 juin 2020, et non pas alors pour la durée restante de son délai légal de réflexion (ce qui amènerait jusqu’au 12 août) mais pour une durée qui repart à zéro, et donc de deux mois pleins (soit jusqu’au 23 août 2020). En effet, il n’est pas prévu la suspension d’un délai commencé avant le 12 mars 2020 (alors qu’une telle suspension est par exemple prévue
à l’article 7 de l’ordonnance, pour les droits de préemption des personnes publiques).
Modalités 2 : le locataire parvient à accepter l’offre de vente le 25 mars 2020, sans déclarer avoir recours à un prêt. Le délai de régularisation de deux mois court à compter de cette acceptation, et expire normalement le 25 mai 2020, soit au cours de la période définie par l’ordonnance. La régularisation de l’acte sera dès lors possible après le 23 juin, et même pendant le délai de deux mois supplémentaire, soit jusqu’au 23 août 2020.
Modalités 3 : si le locataire a accepté (avec recours à un prêt) le 10 mars 2020, il dispose d’un délai de quatre mois pour réaliser la vente soit jusqu’au 10 juillet. Ce délai expirant après le terme de la période définie par l’ordonnance, il ne sera pas prorogé. La conclusion de la vente après le 10 juillet sera tardive, et le bailleur pourrait légitimement refuser de régulariser.
Exemple 10
Soit un congé pour vendre délivré le 15 janvier 2020 (bail à échéance le 31 juillet 2020). Le locataire a accepté dès le 12 février, en déclarant recourir à un prêt. Le délai de régularisation de quatre mois court à compter de cette acceptation, et expire normalement le 12 juin 2020, soit au cours de la période définie par l’ordonnance. La régularisation de l’acte sera dès lors
possible après le 12 juin, voire après le 23 juin, mais jusqu’à quelle date ? Le délai légal, remis à zéro, devrait être de quatre mois, mais l’article 2 de l’ordonnance
pose une limite de deux mois, soit au plus tard le 23 août 2020.
■■D’autre part, une fois le congé notifié, la sortie effective du locataire doit être mise en oeuvre. Les difficultés d’organisation de l’état des lieux et de remise des clés ont déjà été mentionnées à propos de l’entrée, et sont transposables. De même, il a été traité par ailleurs de la restitution du dépôt de garantie.
Mais qu’en est-il du locataire qui, ne pouvant restituer les clés (parce qu’il ne peut déménager, par exemple), se maintient dans les lieux ? Peut-il invoquer la force majeure pour éviter d’avoir à payer au bailleur une indemnité d’occupation ? Pour les raisons déjà évoquées ci-dessus, cette possibilité doit à notre avis être rejetée dans la mesure où il s’agit, là encore, d’une dette de somme d’argent. Le locataire s’expose à devoir payer une indemnité d’occupation (il ne s’agit plus d’un loyer car le bail est bien arrivé à son terme) jusqu’à la restitution effective des lieux.
Son seul argument serait de démontrer qu’il est prêt à remettre les clés, et que c’est le bailleur (ou son mandataire) qui ne répond pas ou ne se déplace pas.
Il appartiendra alors au locataire de restituer les clés par pli recommandé ou par huissier, si cela est possible, tout en essayant également de mettre en oeuvre un état des lieux par huissier.
■■Expulsion
Les mesures d’exécution forcée sont évidemment rendues beaucoup plus difficiles en cette période. Le gouvernement est intervenu afin d’accroître la protection des personnes en passe d’être expulsées.
L’ordonnance no 2020-331 du 25 mars 2020, uniquement consacrée à cette problématique, prolonge pour cette année la trêve hivernale tant en matière d’interruption de fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz pour cause d’impayé dans une résidence principale, qu’en matière d’expulsion.
Dans le premier cas, la période durant laquelle, selon l’alinéa 3 de l’article L. 115-3 du CASF, les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à
l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur et de gaz aux personnes ou familles, a été prolongé, dans un premier temps de deux mois pour expirer le 31 mai 2020 au lieu du 31 mars (avec des dispositions spécifiques pour les collectivités d’outre-mer), puis, dans un second temps (par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions), jusqu’au 10 juillet 2020.
Dans le second cas, le sursis hivernal prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution a, lui aussi d’abord été prolongé, de deux mois pour expirer le 31 mai 2020 au lieu du 31 mars (avec, là encore, des dispositions spécifiques pour les collectivités d’outre-mer), puis, dans un second temps (par la loi du 11 mai 2020 précitée), jusqu’au 10 juillet 2020. Aucune mesure d’expulsion ne pourra donc être engagée au cours de cette période.
Tableau récapitulatif des autres délais pouvant faire l’objet d’un report au titre de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
Contenu de la disposition Texte
Mise en demeure par le locataire de porter les mentions relatives à la surface habitable
– saisine de la juridiction compétente
Art. 3, loi de 1989
Demande en diminution du loyer (surface
habitable)
Art. 3-1, loi de 1989
Demande afin de compléter l’état des lieux Art. 3-2, loi de 1989
Demande afin d’être autorisé à procéder
à des travaux d’adaptation du logement
Art. 7 f, loi de 1989
Prescription des actions Art. 7-1, loi de 1989
Confirmation de l’événement pour un bail à durée réduite
Art. 11, loi de 1989
Mise en demeure (constat d’abandon du logement)
Art. 14, loi de 1989
Résiliation par les bailleurs – établissements publics de santé
Art. 14-2, loi de 1989
Demande de révision du loyer par le bailleur Art. 17-1, loi de 1989
Offre de renouvellement du bail moyennant
un nouveau loyer / saisine de la commission / saisine du juge
Art. 17-2, loi de 1989
Mise à disposition des pièces justificatives des charges
Art. 23, loi de 1989
Résiliation du bail / signification du commandement à la caution
Art. 24, loi de 1989
Contestation du complément de loyer / mention du loyer de référence / action en diminution du loyer / renouvellement du bail avec un nouveau loyer / mise en demeure par le représentant de l’État
Art. 140,
loi du 23 nov. 2018
Dans le cadre des mesures d’urgence sanitaires adoptées par le gouvernement, l’attention en matière locative s’est d’emblée focalisée sur les mesures de « suspension » des loyers
commerciaux, alors qu’une autre question décisive se pose quant à la possibilité de délivrer congé en cette période troublée : les délais de préavis impératifs prévus par les baux immobiliers peuvent-ils, et selon quelles modalités, bénéficier d’un report, à l’instar des délais procéduraux ?
L’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sert de fondement au dispositif de report de la date ultime de délivrance d’un congé, lorsque cette date intervient en cours de période d’urgence sanitaire. Les difficultés matérielles sont en effet nombreuses en cette période, puisque le fonctionnement de la Poste est altéré (cas d’une notification par LRAR – à supposer même que le destinataire soit présent à son domicile), la remise en main propre est, à l’heure des gestes barrières et du confinement, peu envisageable, et la signification par huissier est également nettement ralentie.
Le dispositif, élaboré dans l’urgence, était ainsi nécessaire, mais malgré le rapport au président de la République et la circulaire d’application du 26 mars 2020, certaines zones d’ombre persistent
en matière de résiliation par congé d’un bail immobilier. À défaut d’avoir été levées par l’ordonnance no 2020-427 du 15 avril (portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19), il reste à espérer qu’elles seront éclaircies par la loi de ratification (en principe déposée au Parlement dans les trois mois de la publication de l’ordonnance), et il convient pour ce faire de les identifier.
■■Problème préliminaire :
quel texte appliquer ?
L’ordonnance du 25 mars 2020 contient deux articles susceptibles d’être appliqués à l’hypothèse d’un congé mettant fin à un bail en
cours.
L’article 2 dispose : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
L’article 5 indique quant à lui que : « Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période ».
À première vue, seul l’article 5 concerne l’hypothèse du congé, qui constitue bien un acte unilatéral de résiliation d’un contrat, car, très souvent, si un congé n’est pas délivré, le bail est reconduit pour une nouvelle période.
Cette évidence apparaît toutefois plus fragile en considération des éléments suivants qui pourraient militer pour une application de l’article 2 :
* La circulaire no CIV/01/20 (NOR : JUSC 2008608C)
du 26 mars 2020 ne cite pas le congé dans la liste d’exemples d’application de l’article 5. Elle précise également, à propos de l’article 2, que celui-ci « ne vise que les actes prescrits par la loi ou le règlement et les délais légalement imparti[s] pour agir. Il en résulte que les délais prévus contractuellement ne sont pas concernés ». Or, en matière de bail d’habitation
(art. 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour le congé délivré par le bailleur) ou de bail commercial (art. L. 145-4 C. com. pour le congé à échéance triennale), les délais de préavis (6 mois dans ces deux exemples) ne sont pas d’origine contractuelle, mais bien imposés par la loi.
* Un congé est un acte juridique unilatéral (l’article 2 vise « tout acte ») qui, s’il n’est pas délivré avant la date imposée par les textes, est frappé soit de nullité (ex. d’un congé pour vendre tardif : Civ. 3e, 31 mai 2011, n° 10-30.707, D. 2012. 1086, obs. N. Damas ; AJDI 2011. 799, obs. C. Dreveau), soit d’inefficacité en ce que ses effets sont reportés à la prochaine date utile (V. en matière de bail commercial J.-P. Blatter, Traité des baux commerciaux, 6e éd., Le Moniteur, 2018, no 371). En d’autres termes, il s’agirait ici d’un
acte prescrit par la loi à peine de nullité ou de sanction (ce terme très général pouvant englober l’inefficacité de l’acte), comme le prévoit l’article 2 de l’ordonnance.
Finalement, la seule certitude concerne les baux soumis au code civil (conventions d’occupation précaire, logements de fonction…) qui ne sont soumis
qu’à la seule loi des parties. C’est alors la lecture contractuelle qui doit s’imposer, et donc l’article 5. En revanche, dans les baux à statut (habitation principale, professionnels, commerciaux, ruraux), la prégnance de l’ordre public pourrait les rattacher à l’article 2. La plupart des commentateurs appliquent aux congés les dispositions de l’article 5, et nous rejoignons cette opinion, mais une clarification s’avèrerait nécessaire, et ce d’autant plus que les effets ne sont pas strictement identiques, même si, en définitive, les régimes se rapprochent de facto.
Nous allons présenter le régime de l’article 5, qui selon nous devrait régir l’ensemble des congés, puis
l’enjeu (restreint) de l’application de l’article 2.
par Nicolas Damas
Maître de conférences université de Lorraine (Nancy – IFG EA 7301)
Comment délivrer congé en période d’urgence
sanitaire ?
■■Hypothèse de l’application de l’article 5
« Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période. »
Ce texte met en avant les conséquences d’un défaut de résiliation au cours d’une période déterminée : soit la résiliation n’est plus possible, soit la convention est renouvelée. Il apparaît donc que l’enjeu (la sanction) de la bonne délivrance du congé à une date précise est un critère déterminant afin qu’un report soit possible.
Champ d’application
Il convient de distinguer selon que le bail étudié est soumis aux lois du 6 juillet 1989 (bail d’habitation) ou du 23 décembre 1986 (bail professionnel), ou aux
articles L. 145-1 et suivants du code de commerce (bail commercial).
Bail d’habitation et bail professionnel
L’on constate tout d’abord que le congé par le locataire, qui peut être donné à tout moment et sans risque, à défaut, de renouvellement imposé, n’est pas concerné par le texte. Comme il n’est pas soumis à une obligation de respecter une période déterminée afin de délivrer congé, un report de période n’a pas lieu d’être. Certes, le locataire est exposé aux mêmes difficultés matérielles de notification du congé, mais son risque est finalement limité à un retard de notification, et donc de point de départ du préavis. Il ne peut que prendre son mal en patience.
Il est à noter que si le congé par le locataire a pu être délivré, le préavis légal (un ou trois mois en matière de bail d’habitation, six mois en matière de bail professionnel) s’appliquera sans qu’il ne soit affecté d’un quelconque report par l’ordonnance du 25 mars 2020.
Du côté du bailleur, les enjeux sont plus importants. Prenons comme exemple un bail (d’habitation nue ou professionnel) expirant le 31 octobre 2020 : le congé par le bailleur doit être délivré au plus tard (préavis de six mois) le 30 avril 2020. Un report est-il possible ? L’hypothèse adéquate prévue par l’ordonnance semble être la suivante : « Lorsqu’une convention […] est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé […] ». En l’occurrence, si le congé n’est pas délivré dans ce délai de six mois, un nouveau contrat se formera en effet à l’issue de la période initiale. À proprement parler, il ne s’agit pas d’un renouvellement (acte exprès), mais d’une tacite reconduction (l’art. 10 de la loi du 6 juill. 1989 distingue bien les deux hypothèses, et l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 évoque la tacite reconduction).
Il faut espérer qu’une interprétation large prévaudra, même s’il serait plus sécurisant que la loi de ratification précise expressément : « ou qu’elle est renouvelée ou tacitement reconduite en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé ».
Sous cette réserve, l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 s’applique sans conteste aux congés délivrés par le bailleur dans le cadre d’un bail d’habitation ou d’un bail professionnel.
Bail commercial
La difficulté est ici similaire, voire plus grande encore, car les termes de l’ordonnance que nous avons mobilisés dans le cadre d’un bail professionnel ou d’un bail d’habitation ne sont guère appropriés.
– Soit le congé, par le locataire ou par le bailleur, est donné en vue d’une échéance triennale (C. com., art. L. 145-4), et alors à défaut, le bail initial continue ; il n’y a en conséquence ni renouvellement, ni tacite reconduction (ce dernier terme ne figurant d’ailleurs pas dans l’ordonnance).
– Soit le congé (ou la demande de renouvellement) est donné après l’échéance du bail, mais alors celui-ci, en tacite prolongation, n’a pas pris fin (C. com., art. L. 145-9). Le défaut de congé (ou de demande de renouvellement) n’entraîne nullement son renouvellement…
Au contraire, c’est uniquement l’initiative des parties qui peut provoquer ce renouvellement !
Il faut donc en déduire qu’une partie des termes de l’article 5 de l’ordonnance, efficaces en matière de bail professionnel et de bail d’habitation, le sont moins en matière de bail commercial. Il serait en revanche plus pertinent de faire application de la première hypothèse visée par l’article 5 : « Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ». Cette période serait celle qui précède la date ultime à laquelle le congé serait efficace/valable (jusque six mois avant le terme, pour un bail d’habitation, et avant l’échéance triennale pour un bail commercial).
Cela résoudrait ainsi de nombreuses difficultés, mais pas toutes : si le congé n’est pas donné en vue de l’échéance des neuf ans (soit au plus tard six mois avant ce terme), il peut ensuite être délivré à tout moment avec un préavis différent (six mois à l’avance pour le dernier jour du trimestre civil). En conséquence, en tacite prolongation d’un bail commercial, il n’y a pas de limite temporelle à la possibilité de donner congé (ou de demander le renouvellement), donc pas de période à ne pas dépasser…. Il faudrait ainsi en déduire que l’article 5 de l’ordonnance ne pourrait permettre un quelconque report en matière de congé ou de demande de renouvellement formulé à l’échéance du bail commercial ou en tacite prolongation (de manière similaire à ce qui a été exposé à propos du congé délivré par le locataire en matière de bail d’habitation).
Les enjeux peuvent être pourtant importants : ainsi, lorsque s’approche la fin de la douzième année, le locataire peut avoir intérêt à demander le renouvellement avant que cette durée ne soit atteinte afin d’éviter un déplafonnement du loyer (C. com., art. L. 145-34).
Modalités du report
Principe. Si l’on admet l’application de l’article 5 aux congés (en vue de l’échéance triennale en matière commerciale, du terme en matière d’habitation et de bail professionnel), le texte précise que
« cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la
Exemple 1
Bail (initialement de neuf ans) atteignant douze ans le 1er juin 2020.
Le locataire pourrait éviter le dépassement de cette durée en demandant le renouvellement avant le 31 mars 2020, avec effet au 1er avril 2020. S’il n’a pu matériellement le faire, peut-il arguer d’un report de cette possibilité ? À notre avis, le texte ne l’autorise pas, car il ne s’agit pas d’une période limitée de résiliation (du bail en cours) mais seulement des conséquences sur le loyer, du fait du non renouvellement dans le délai imparti pour éviter le déplafonnement.
période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période ». Le caractère succinct de la disposition ne facilite pas, là encore, son interprétation.
Période concernée. La période (qualifiée de période juridiquement protégée – PJP – par la circulaire du 26 mars 2020) définie au I de l’article 1er renvoyait à la période d’état d’urgence sanitaire (PEUS), définie par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, augmentée d’un mois. Le point de départ de la PEUS était, selon cette loi, le 12 mars 2020 et le point d’arrivée le 23 mai 2020 à minuit. La PJP court dès lors du 12 mars au 23 juin 2020 à minuit. La date du 23 juin 2020 comme terme de cette PJP a été confirmée en tant que telle (et donc indépendamment de la PEUS qui quant à elle a été décalée au 10 juillet 2020) par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 (qui a modifié l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020).
Si la date limite pour délivrer congé intervient au cours de cette PJP, le texte précise que « cette période ou ce délai sont prolongés […]
de deux mois après la fin de cette période », soit jusqu’au 23 août 2020 inclus. La prolongation est automatiquement de deux mois.
Difficultés. Il peut tout d’abord arriver que l’échéance du bail soit intervenue (et donc que le cocontractant – le locataire – puisse penser se trouver dans un nouveau bail tacitement reconduit), et
pourtant, un congé délivré postérieurement sera censé avoir été efficacement délivré pour s’opposer à cette tacite reconduction…
Cette situation se présentera lorsque le préavis est court, comme en matière de bail d’habitation portant sur un logement meublé.
Une incertitude règnera tant que cette date du 23 août ne sera pas dépassée, créant ce qui a été qualifié de « situation contractuelle inédite » (N. Cayrol, État d’urgence sanitaire : dispositions générales relatives aux délais, JCP 2020. 481). En cas de prolongation de la PJP, les hypothèses se multiplieraient.
Une autre difficulté a trait au préavis devant être respecté. L’ordonnance ne précise pas que c’est l’échéance du bail qui est prolongée, mais uniquement la date possible de délivrance du congé. Or, le préavis est en principe calculé à rebours de l’échéance contractuelle, plutôt qu’à compter de la délivrance du congé. C’est ainsi particulièrement net en matière de congé pour vendre (art. 15-II
de la loi du 15 juillet 1989), où l’offre est valable pendant les deux premiers mois du préavis, calculé en se référant au point de départ théorique de ce délai (Civ. 3e, 23 févr. 1994, n° 91-22.298, D. 1996. 372, obs. CRDP Nancy II).
Il est certes impossible d’imaginer que le congé, délivré efficacement à une date qui serait normalement considérée comme tardive, ne soit pas assorti d’un délai de préavis. Mais quelle durée lui affecter ? La référence à l’échéance du bail paraît à cet égard peu satisfaisante, car elle conduirait à un préavis très court (exemple 2 : du 10 juillet au 31 octobre) voire inexistant (exemple 3 :
terme précédant la délivrance du congé…).
Le consensus semble l’emporter sur l’application des délais de préavis prévus par les textes (V. B. Vial-Pedroletti, Épidémie de Covid-19 et bail d’habitation : les questions que pose le confinement,
Loyers et copr. mai 2020 ; C. Gisbers, Flash Cridon Paris 30 mars 2020 ; adde la fiche mise en ligne par le Ministère de la justice : www.justice.gouv.fr/consequences-juridiques-etat-durgence-sanitaire-12982/°).
Ainsi, dans l’exemple 2, le congé délivré le 10 juillet 2020 conduirait à la mise en oeuvre d’un délai de préavis de six mois (durée expressément mentionnée à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 et l’article L. 145-4 du code de commerce), et produirait donc effet au 10 janvier 2021. Dans l’exemple 3, le congé par le bailleur produirait effet après un préavis de trois mois (art. 25-8, loi du 6 juillet 1989), soit, s’il a été délivré le 23 août, le 23 novembre 2020.
L’inconvénient de ces solutions de bon sens est que le renouvellement (ou la tacite reconduction) du bail est censé avoir été empêché à la date d’échéance normale de ce bail. En d’autres termes, décaler le préavis à partir de la date de notification réelle du congé revient à reporter le terme, donc à prolonger le bail…
En toute rigueur, cela nous semble contestable sans un support textuel. Une telle disposition existe par exemple lorsque le droit pour le bailleur de délivrer
congé est suspendu (dans le cas d’un logement menaçant ruine, selon l’art. 15-I de la loi du 6 juillet 1989) et il est alors expressément prévu que la durée du bail est également suspendue. De même, depuis la loi Macron du 6 août 2015, lors de l’acquisition d’un logement occupé, l’acquéreur qui délivre congé pour reprise voit, dans une circonstance particulière, la prise d’effet de ce congé décalée jusqu’à l’expiration d’une certaine durée : si le texte ne mentionne pas le report du terme du contrat, il énonce tout de même clairement le décalage et l’échéance du nouveau préavis imposé.
Voilà pourquoi il nous semble que, pour sécuriser pleinement la solution consistant à appliquer, légitimement, la durée de préavis prévue par les textes légaux, la loi de ratification devrait indiquer, en complément de l’article 5 : « le délai de préavis contractuellement ou légalement imposé se décompte alors à compter de la notification de la dénonciation ou de la résiliation ».
■■Hypothèse d’application de l’article 2
La différence de régime avec l’article 5 de l’ordonnance tient ici à ce que l’acte (le congé s’il est bien visé par le texte) sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Exemple 2
Reprenons l’hypothèse du bail d’habitation (vide) ou professionnel expirant le 31 octobre 2020 (transposable à une échéance triennale de bail commercial à la même date). Le bailleur (et le preneur commercial) devrait délivrer congé au plus tard le 30 avril 2020. Cette date se trouvant en cours de la PJP, la date limite pour délivrer congé serait prolongée jusqu’au 23 août 2020. Un congé délivré par exemple le 10 juillet sera censé avoir été délivré efficacement au regard des textes imposant une date limite de délivrance du congé.
Exemple 3
Soit un bail meublé (préavis de trois mois pour le bailleur) venant à expiration le 31 juillet 2020. Le bailleur devrait donner congé au plus tard le 30 avril (préavis de trois mois pour le bailleur). Le report le conduira à pouvoir délivrer congé jusqu’au 23 août, empêchant la reconduction tacite d’un bail, plusieurs semaines après que celle-ci se soit théoriquement réalisée…
La prolongation de deux mois n’est nullement automatique ici. Il s’agit d’un maximum prenant en considération le délai initialement prévu par le texte.
Seulement, en matière locative, les préavis concernés excèdent deux mois : ils sont en principe de six mois (congé par le bailleur d’habitation, congé commercial, congé par le bailleur professionnel), voire de trois mois (congé par le bailleur d‘habitation meublée).
Dès lors, l’on peut supposer que le report sera toujours automatiquement de deux mois, soit jusqu’au 23 août 2020, ce qui rapproche grandement les modalités de l’article 2 et de l’article 5…
L’enjeu réel serait que selon l’article 2, l’acte est « réputé avoir été fait à temps », ce qui empêcherait à notre avis d’appliquer un délai de préavis courant à compter de la notification effective du congé. Cet inconvénient ne peut qu’inciter à exclure clairement l’application de l’article 2 aux congés.
■■Hypothèses exclues de tout report
Si l’échéance ne s’est pas terminée au cours de la PJP, elle ne peut être décalée. Par ailleurs, le report n’est qu’une faculté que le sujet de droit peut écarter s’il parvient à faire délivrer son acte.
Échéance en dehors de la période définie par l’ordonnance
Dès lors que la PJP a bien été confirmée comme courant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, il est acquis
que :
■■si la date limite de délivrance du congé est antérieure au début de la période (soit jusqu’au 11 mars 2020 inclus), aucun report ne peut être mis en oeuvre.
■■si la date limite de délivrance du congé est postérieure à la fin de la PJP, soit après le 23 juin 2020, aucun report n’est là non plus prévu.
Le congé devra être délivré avant la date initialement imposée par les textes ou le contrat.
Efficacité de l’acte délivré même en cours de période
Par ailleurs, il est important de relever que le régime de report des délais est un assouplissement des règles normalement applicables, qui ne remet pas en cause la validité ou l’efficacité des actes
notifiés au cours de cette période. Il s’agit en effet d’une règle de nature optionnelle.
Cela résulte clairement du rapport présenté au président de la République : « Ainsi, l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti » (à propos de l’article 2 de l’ordonnance, mais selon nous transposable à l’article 5).
Exemple 4
Un bail professionnel vient à échéance au 31 août 2020. Le bailleur aurait dû délivrer congé au plus tard le 29 février 2020. Un congé délivré après cette date serait irrévocablement tardif et ne pourrait être « rattrapé » sur le fondement de l’ordonnance.
Exemple 5
Un bail commercial est à échéance triennale le 31 décembre 2020. Le preneur a jusqu’au 30 juin 2020 pour donner congé. Il ne bénéficiera d’aucun report.
Exemple 6
Si un bail vient à échéance le 31 octobre 2020, et que la date ultime de délivrance d’un congé est fixée au 30 avril 2020, le report jusqu’au 23 août peut jouer. Mais un congé délivré le 20 avril 2020 produira bien ses effets à la date prévue (31 oct. 2020). L’auteur du congé n’a pas besoin du report puisqu’il est parvenu à délivrer congé malgré le contexte de crise.
Exemple 7
De même, si un congé avec un préavis de trois mois a été délivré par un bailleur le 15 mars, avec effet au 15 juin (échéance du bail meublé), cet acte produira ses effets à la date prévue, sans que le
report soit nécessaire. Et il importera peu que la date d’effet du congé tombe au cours de la période définie par l’ordonnance, puisque celleci n’affecte pas la durée du préavis.